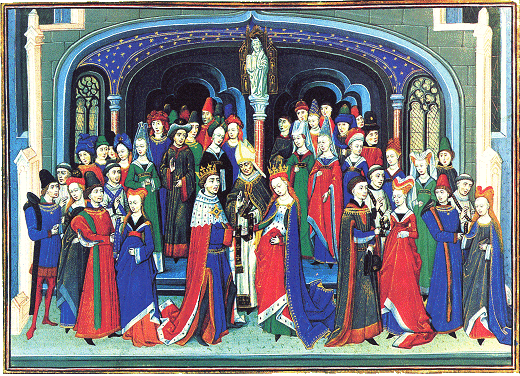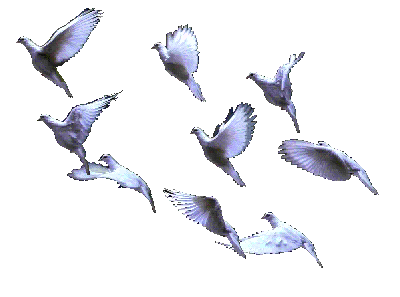La chanson française sous l’occupation allemande :
une douteuse cohabitation
Tout acte culturel, toute consommation de biens ressort à une démarche de multiplication. Toute pratique commune exprime une “ sociabilité du sensible ”
En 1939, en France, la radio touchait un public de masse (5 millions de postes récepteurs). Il était naturel que l’occupant nazi, les collaborateurs, mais aussi les[2] résistants de Londres s’intéressent à ce nouveau moyen de communication de masse et ce qu’il véhiculait en priorité : information, propagande et divertissement.
A l’orée de la guerre, la chanson était passée depuis une décennie de la salle de spectacle aux ondes radiophoniques. Dans le climat post-munichois et celui de la “ drôle de guerre ”, les chansons de qualité à succès étaient celles, quelque peu acidulées, ironiques ou parodiques de Pills et Tabet ou de Mireille et de Jean Nohain (“ Couchés dans le foin ”, “ Le vieux Château ”). Juste avant la conflagration, Charles Trénet avait popularisé l’insouciant “ Y’a d’la Joie ” :
Y’a d’la joie
Bonjour, bonjour les hirondelles
Y’a d’la joie
Dans le ciel par dessus les toits.
et le fameusement — quoique involontairement — proleptique “ Boum ” :
Boum!
Quand notre cœur fait boum!
Tout avec lui dit boum!
Et c’est l’amour qui s’éveille.

Émotion et surréalisme avait envahi la vie quotidienne des Français. Dans le même temps, le climat international devenant tendu, la chanson patriotique, pratiquement disparu depuis 1920, refleurit. Des auteurs de chansons tentent de retrouver le style des années 1870 à 1914. Lucienne Boyer chante “ La Fille à Madelon ”, et George Thill prévient : “ Ils ne passeront pas! ” :
Pétain a dit à ses soldats :
Soyez certains, ils n’passeront pas
Il faut qu’on tienne
Ce genre patriotique rencontre assez peu de succès, à l’exception de “ Ça fait d’excellents Français ” de Georges Van Parys, créée par Maurice Chevalier. Cette chanson au ton primesautier envoie un double message : les Français sont pacifiques, rigolards, pour tout dire Gaulois; et, dans le même mouvement, ils peuvent faire face à la guerre, réapprendre d’instinct à marcher au pas, respecter à nouveau l’uniforme. Dès le début de l’occupation allemande, s’engouffrent des créations réalistes exprimant la solitude, le vague à l’âme, l’incertitude : “ Je suis seule ce soir ”, “ J’attendrai ”, “ Attends-moi mon amour ”. Les grands music halls (Les Folies Bergères, le Concert Mayol, le Lido, l’A.B.C. qui accueille la revue de Gilles Margaritis Chesterfollies et tous les grands noms du tour de chant de Tino Rossi à Léo Marjane) sont alors bondés de civils français côtoyant sans vergogne les uniformes des officiers de la Wehrmacht. Les filles déshabillées, les plumes, le strass redonnent vie au Paris insouciant et frivole de la Belle Époque.
Mais la France est terrassée. Des centaines de milliers de famille ont fui leurs foyers. Le pays est coupé en deux. L’Alsace a été réannexée et le Nord est administré directement par l’occupant. Cela n’empêche pas Maurice Chevalier et son ami, l’ancien champion du monde de boxe Georges Carpentier de faire de la publicité pour les vélos-taxis puisque la circulation demeure interdite. Le même Chevalier entonne alors une chanson très entraînante, quoique reflétant bien peu le réel :
Tsimpa Poum Pala
C’est notre espoir

Le régime de Vichy traduit dans les faits la revanche d’une France passéiste et réactionnaire sur l’“ ennemi intérieur ” : francs-maçons, démocrates, communistes et, bien sûr, Juifs. L’armée française a été balayée mais ses fanfares jouent dans les kiosques. Radio Paris, contrôlée par la puissance occupante, explique que la défaite était méritée. La résistance gaulliste répond sur les antennes de la BBC que “ Radio Paris ment, Radio Paris est allemand ”. L’ordre nouveau du Maréchal Pétain exalte la terre — qui, selon le slogan du philosophe Emmanuel Berl[3], « ne ment pas », et aussi le grand air, le folklore. La radio diffuse des chansons paysannes jusqu’à satiété :
Aimons nos montagnes
Nos Alpes de neige
Aimons nos campagnes
Que Dieu les protège
La chanteuse fantaisiste Marcelle Bordas s’illustre en vantant le retour à la terre :
Ah, comme la France est belle
Et comme on se sent fier
D’être un de ses enfants

Le travail manuel est réhabilité, tout comme les exercices physiques. Maurice Chevalier, qui est depuis longtemps le chanteur français le plus populaire, crée “ La Chanson du maçon ” :
Si tout le monde apportait son moellon
Nous rebâtirions notre maison
Qui deviendrait
La maison du bon Dieu
La radio pétainiste programme en priorité des chansons où la propagande se veut discrète, mais qui expriment la nostalgie pour un passé insouciant et un présent qui se veut éloigné des tristes réalités. La chanson d’amour se porte à merveille (“ Le premier rendez-vous ”), tout comme celle qui fait appel au folklore campagnard (“ Le petit vin blanc qu’on boit sous les tonnelles ”), à une France éternelle, intouchée (“ Ça sent si bon la France ”, par Maurice Chevalier). Même Jacques Prévert, poète d’extrême-gauche qui animait peu de temps avant le début des hostilités le groupe théâtral Octobre, seule troupe d’agit-prop ayant connu quelque succès, se limite à des textes purement poétiques. Charles Trénet chante “ Terre ”, et André Dassary, basque très populaire, ancien chanteur de l’orchestre de Ray Ventura, “ Vive la terre de France ” :
Pour que le pays soit plus beau
Il faut des bras pour la charrue
Pour Pétain le Front Populaire avait été une période de jouissance fautrice de décadence et de guerre. Il interdit les bals populaires où l’on dance, où l’on se touche, et où l’on peut parler. Les chansons s’adressent maintenant aux prisonniers et à toutes les personnes déplacées, déboussolées : “ Ça sent si bon la France ”. Le régime remet à l’honneur de vieilles chansons traditionnelles : “ Sur la route de Louviers ”, “ Une fleur au chapeau ”. Mais au hit-parade de la chanson pétainiste, grimpe en quelques semaines un véritable petit chef d’œuvre : “ Maréchal, nous voilà ” de Charles Courtiaux et André Montagard. André Dassary en fait l’hymne officieux du régime :
Une flamme sacrée
Monte du sol natal;
Et la France enivrée
Te salue, Maréchal.
Maréchal, nous voilà
Devant toi, le sauveur de la France,
Nous jurons, nous tes gars,
De servir et de suivre tes pas.
Maréchal, nous voilà,
Tu nous as redonné l’espérance.
La patrie renaîtra,
Maréchal, Maréchal,
Nous voilà!

Cela dit, les Allemands et Vichy se servent assez peu de la chanson dans la propagande de tous les jours. Rares sont les chansons qui prônent ouvertement la collaboration. Les hitlériens français empruntent au répertoire allemand (“ J’avais un camarade ”). la propagande préfère utiliser des vedettes de second plan pour proposer des programmes lénifiants, sans aucune prise avec le réel. C’est le cas d’André Claveau qui, à Radio Paris, station contrôlée par les Allemands, anime une émission pour les femmes, “ Cette heure est à vous ”. Outre Claveau, la plupart des vedettes des années trente poursuivent leur carrière, à Paris ou en zone non occupée : Raymond Legrand et son orchestre s’engouffrent dans le créneau laissé vacant par Ray Ventura qui a dû émigrer, Jean Sablon (“ Je tire ma révérence ”), Léo Marjane, et, bien sûr, Édith Piaf, Charles Trénet et Maurice Chevalier. The show must go on at all costs. Les chanteurs acceptent quelques compromissions bénignes ou quelques prestations douteuses : un récital bien payé pour Radio Paris, un gala au profit du Secours National. Une minorité finira par accepter de se rendre en Allemagne en échange, pour satisfaire leur conscience, de la libération de quelques prisonniers de guerre. On trouve par exemple dans l’édition française de Signal un article sur Maurice Chevalier chantant “ Ya d’la joie ” devant une salle de prisonniers de guerre en janvier 1942, dans le Stalag d’Alten-Grabow où il avait été lui-même prisonnier pendant la première Guerre Mondiale. Il se dit “ reconnaissant aux autorités allemandes ” car, en échange de sa venue, elles ont libéré quelques Français[4]. Susy Delair, Albert Préjean, Viviane Romance répondent à l’invitation de Karl Frölich, le président de la Corporation du Cinéma Allemand. Piaf, Trénet, Léo Marjane[5], Raymond Legrand et son orchestre se produisent dans des stalags ou dans des salles de spectacle de grandes villes allemandes jusqu’en 1943[6]. Le grand succès des premières années de guerre, celui qui, par delà l’horreur du conflit, unit les militaires et les civils français et allemands, reste la version française de “ Lily Marlène ”, créée par Suzy Solidor[7].

Le comique troupier Ouvrard est stipendié par l’organisation Kraft durch Freude. Pour l’occupant, les vedettes françaises, une fois leurs remords apaisés, doivent œuvrer en ambassadeurs auprès des prisonniers, puis des Français envoyés en Allemagne au titre du Service du Travail Obligatoire. Qu’elles le veuillent ou non, ces vedettes justifient la soumission de la France à l’Allemagne puisqu’elles font passer comme un état de fait naturel la collaboration politique, économique et culturelle entre les deux pays. Heureusement, ces faiblesses, ces compromissions avec l’occupant seront assez rares, malgré des cachets très substantiels. Un passage à Radio-Paris peut rapporter trente fois le salaire mensuel d’un ouvrier. Parfois même, en présence des Allemands, certaines vedettes se risquent à d’authentiques provocations. Ainsi, un soir de 1942, à la fin d’un tour de chant à l’A.B.C., Édith Piaf, illuminée par le drapeau tricolore français, lance devant plusieurs rangées d’officiers allemands : « Où sont-ils tous mes copains? ». Le public français exulte.[8]
Rares sont les chanteurs allemands qui parviennent à s’imposer sur les scènes ou les ondes françaises. Quelques femmes réussissent dans un registre sensuel : Marika Rokk, Eva Busch et la suédoise Zarah Leander.
Les Allemands et les Vichystes partagent la même préoccupation : distraire les Français, offrir à une société écrasée de problèmes mais qui, globalement est restée sur ses rails, les formes d’expression artistiques qu’elle souhaite : tradition et innovation afin d’éviter des troubles dans la population. Alors, comme le disait si bien le commandant du gross Paris, “ Paris sera toujours Paris ”. Dès juillet 1940, le Casino de Paris rouvre des portes sur lesquelles on peut lire “ Interdit aux Juifs et aux Chiens ”. Le grand hall d’entrée, couleur locale oblige, est transformé en brasserie. Mistinguett, la vedette féminine la plus populaire de France (inoubliable créatrice de “ Mon homme ”), y fait sa rentrée. Les Folies-Bergères rouvrent pour un public composé en très grande majorité d’officiers allemands. Les cabarets ne désemplissent pas : Le Lido, Le Bosphore, Le Tabarin. Tout comme les bordels, dont une dizaine sont réservés à l’usage exclusif des soldats allemands du rang et cinq aux officiers de la Wehrmacht. Le plus célèbre, le One-Two-Two, est situé rue de Provence, en plein centre de Paris. Mais la soldatesque n’est pas assez nombreuse pour permettre à ces maisons closes de faire leurs affaires, et les Allemands finissent par accepter les clients français. L’ambiance est alors merveilleuse, le champagne coule à flots. Les “ maisons” permettent des rencontres officieuses : les Allemands des bureaux d’achat clandestins côtoient les tortionnaires français et gestapistes de la rue Lauriston, mais aussi le Tout-Paris du spectacle : Sacha Guitry, Vincent Scotto, Maurice Chevalier, Tino Rossi.

En 1943, la collaboration politique jette ses derniers feux. Laval est bien seul à croire à la « pérennité de l’Europe nouvelle ». En mai, il propose au GauleiterSauckel la négociation d’un large accord (ein Ausgleich)[9]. La Milice, organisation française fasciste armée par l’occupant et chargée de détruire la Résistance, est haïe de la population. La propagande pétainiste est désormais totalement sans effet. Cela n’empêche pas Tino Rossi de dédier à ses amis du Stalag13B “ Quand tu reverras ton village ” (“ tu diras : rien chez moi n’a changé ”). En écho naissent quantité de chansons de résistance, de réelle solidarité avec les prisonniers, chansons “ scies ” détournant des succès bien établis, comme la Marseillaise des prisonniers :
Ils sont foutus
Et le monde avec allégresse
Répète avec joie sans cesse
Ils l’ont dans l’cul
Dans l’cul.
La France occupée est placée sous les ordres du Militärbefehlshaber. De son administration dépend la Propaganda Abteilung et la Propaganda Staffel qui, à Paris, surveille en particulier le monde du music-hall. Il est difficile de définir la politique de censure de ces services. On ne saurait dire qu’elle répond à des impératifs culturels précis, au sens où, par exemple, l’occupant ne cherche pas à imposer les modèles culturels dominant en Allemagne. Certaines manifestations qui seraient tenues pour décadentes en Allemagne sont tolérées en France[10]. En revanche, les Nazis sont très attentifs au respect de certains interdits politiques et raciaux : les Juifs et le communistes sont traqués. La chanson française sous l’occupation tentera assez peu de tromper la vigilance des censeurs. Ce sera, de toute façon, de manière indirecte. Ainsi, tel auteur omettra un couplet anglophile avant de soumettre son texte à la censure avant de le réintroduire une fois l’imprimatur obtenue. Ailleurs, certains auteurs risqueront des propos allusifs, comme, par exemple, pour “ La Chanson du maçon ” de M. Vandair et H. Betti. Un maçon chante une chanson reprise par un deuxième maçon, puis par un troisième etc., jusqu’à ce qu’il se crée un sentiment de solidarité dans la profession. Mais l’esprit corrosif était alors tellement peu marqué que la chanson fut perçu par les autorités de Vichy comme relevant de l’esprit de la Révolution Nationale, avant d’être interdite sur les ondes françaises parce qu’elle avait été diffusée par la BBC.
Si de nombreux chanteurs se produisirent à Radio Paris, voire en Allemagne, il ne faut pas oublier ceux qui refusèrent toute compromission avec l’occupant ou les collaborateurs, et qui s’exilèrent pour se mettre au service de la résistance à Londres. On citera, parmi d’autres, Pierre Dac, Joséphine Baker (la très populaire meneuse américaine de la “ Revue nègre ” dans les années trente), Germaine Sablon (la sœur de Jean Sablon), et Anna Marly.
Une des armes favorites de ces résistants radiophoniques est la satire, dans laquelle excelle Pierre Dac (“ A dit Lily Marlène ”, “ La Défense élastique ”). D’autres textes, plus graves, parviennent jusqu’aux maquis, souvent par voie orale :
Le vent souffle sur les tombes
La liberté reviendra
On nous oubliera
Nous rentrerons dans l’ombre
C’est à Londres, dans un petit club animé par la musicienne Anna Marly, que naîtra la chanson la plus célèbre de la Résistance, “ Le Chant des Partisans ”, sur des paroles de Joseph Kessel (ami de Mermoz et de Saint-Exupéry) et son neveu Maurice Druon (futur Académicien Français).

D’abord sifflé par l’acteur Claude Dauphin (ainsi, il perçait efficacement le brouillage ennemi) et chanté par Germaine Sablon dans le film d’Albert Cavalcanti Pourquoi nous combattons, ce chant poignant et violent est enregistré par Anna Marly, dans les studios de la BBC, puis imprimés dans les Cahiers de la Libération, et parachuté par la Royal Air Force en France. Ce chant est destiné à exprimer la force contenue que chaque combattant peut apporter au grand fleuve de la Résistance. Cet hymne de l’ombre est caractérisé par un rythme lent, une métrique inhabituelle — vers de 11 pieds, chute de 3 pieds —. La mélodie progresse par imitation et retrouve sonpoint de départ à chaque chute de rythme. Chant du combattant, il valorise le maquisard et, à travers lui, les classes sociales qui supportent l’essentiel de la lutte, qui payent « le prix du sang et des larmes ». La reconnaissance de cet état de fait par deux auteurs d’obédience gaulliste n’en est que plus significative.[11] Un murmure sourd, appel à combattre, devient ainsi un cri éclatant né des entrailles de la terre, et destiné à venger ceux qui sont morts au combat ou qui croupissent dans les geôles de l’occupant :
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux
Sur la plaine?
Ami, entends-tu le chant lourd du pays
Qu’on enchaîne?
Ohé, partisans, ouvriers et paysans
A vos armes!
Ce soir, l’ennemi connaîtra le prix du sang
Et des larmes.
[…]
Ici, nous, vois-tu
Nous on marche,
Nous on tue,
Nous on crève!
Dans un pays qui n’entrera en résistance que progressivement, un phénomène inattendu exprime, dans les villes du moins, un fossé entre générations : le mouvement zazou. Des jeunes bourgeois, passablement inconscients, défient l’ordre moral vichyste, voire l’occupant. Leurs motivations sont infiniment moins politiques que ludiques. Leur inspiration première vient d’outre-Atlantique : ils veulent swinguer et écouter du jazz. Le swing était apparu en France avant-guerre, défendu par exemple par Johnny Hess, le pianiste du duo Charles (Trénet) et Johnny (“ Je suis swing ”, “ Ils sont zazous ”). A partir de 1941, le swing contamine les productions d’artistes fort différents : le guitariste de jazz Django Reinhardt (qui enregistra des morceaux mémorables avec le violoniste Stéphane Grapelli et qui fut occasionnellement invité à se produire en direct à Radio-Paris qui oubliait ainsi qu’il était Gitan) introduit du swing dans son jeu, le chanteur un peu mièvre Réda Caire chante “ Swing swing, Madame ”, Jacques Pills propose “ Elle était swing ”. De musical, le mouvement devient culturel, dès lors que des bandes de jeunes adoptent un comportement swing, en s’affublant du nom de zazou, mot emprunté à une chanson de Johnny Hess (“ Je suis zazou, zazoué ”), ce chanteur ayant à l’oreille le “ Zah, zuh, zah ” de Cab Calloway (1933) :
Now, here's a very entrancing phrase,
It will put you in a daze,
To me it don't mean a thing,
But it's got a very peculiar swing!
Zaz-zuh-zaz-zuh-zaz,
Zaz-zuh-zaz-zuh-zay.

En un temps où tous les produits de base sont sévèrement rationnés, les zazous choquent principalement par leur tenue vestimentaire. Ils prennent le contre-pied du jeune homme tel que le propose la propagande pétainiste : vêtements stricts et fonctionnels sur un corps vigoureux et martial. Le zazou choque par son allure quasiment dégénérée : cheveux longs, veste longue, allure voûtée, nœud de cravate ridiculement petit, chaussettes multicolores, semelles compensées. La jeune fille zazoue porte une coiffure compliquée, une veste très longue, une jupe s’arrêtant au dessus du genou et des semelles compensées en bois. L’idole féminine des zazous est Irène de Trébert (“ Mademoiselle Swing ”), la femme de Raymond Legrand. Les zazous affichent que leurs priorités ne sont pas celles du régime, ni celles du peuple qui survit. S’habillant au marché noir de manière raffinée et ostentatoire, ils nient le discours pétainiste selon lequel la France doit payer par la souffrance la jouissance qu’a permis le Front Populaire en 1936-1937. Les zazous aiment le jazz, la danse syncopée par des rythmes américains, les surprises-parties (terme qu’ils importent), les cigarettes américaines de contrebande, les claquettes. Des jeunes pétainistes n’hésitent pas à les brutaliser physiquement, préfigurant le bashing des skinheads contre les hippies dans les années soixante. La propagande officielle les qualifie de décadents, de communistes ou de Juifs. De fait, ils appartiennent à des milieux aisés, non juifs et certainement pas communistes. Leur souci n’est pas de résister au sens noble du terme mais d’exprimer le refus de subir la guerre comme tout le monde, le droit de défier les interdits et l’espoir d’échapper au Service du Travail Obligatoire. Le mouvement zazou durera trois ans, jusqu’à la libération, l’arrivée des troupes américaines, avec leur musique, leurs films, leur Coca Cola. Les zazous tenteront de ressusciter dans les caves de Saint-Germain des Prés, mais en vain.
Pour terminer, j'évoquerai l’évolution de deux monstres sacrés de la chanson française pendant ces années noires, Charles Trénet et Maurice Chevalier. Chevalier, qui âgé d’une cinquantaine d’années au début des hostilités jouit d’un statut de vedette internationale, fait assez rare pour un chanteur français; Trénet[13] qui, bien qu’âgé de vingt-sept ans seulement en 1940, est déjà le plus prometteur et le plus talentueux des auteurs compositeurs interprètes.
Bien que sans engagement politique véritable, Trénet était apparu au moment du Front Populaire comme le chanteur exprimant le mieux les aspirations de la jeune aspiration de l’époque, celle qui put, grâce aux avancées sociales de 1936-7, jouir d’une liberté nouvelle, découvrir les routes de France, espérer en des lendemains meilleurs, bref errer sur “ La Route enchantée ” (1938) :
Une étoile m’a dit,
Deux étoiles m’ont dit :
Connais-tu l’pays du rêve?
[…]
Les joyeux matins
Et les grands chemins
Où l’on marche à l’aventure
Jamais peut-être un chanteur français n’a exprimé avec autant de tonus (“ Je chante soir et matin ”) la joie de vivre. Et, avec discrétion mais très explicitement, un grain de folie qui, bizarrement, passe très bien après des siècles de cartésianisme :
On voit l’facteur
Qui s’envole là-bas
Comme un ange bleu
Portant ses lettres au Bon Dieu (“ Y’a d’la joie ”)
Ficelle, tu m’a sauvé la vie
Ficelle sois donc bénie
Car grâce à toi
J’ai rendu l’esprit
Je m’suis pendu cet’ nuit
Et depuis je chante
Un fantôme qui chante
On trouve ça rigolo (“ Je chante ”)
On le surnomme d’ailleurs “ le fou chantant ”, peut-être en hommage à Al Johnson, “ The Singing Fool ”. Avec la débâcle et un bref passage dans l’armée de l’air, il choisit de rester et de travailler en France. Il reprend ses spectacle à Paris dès février 1941. En 1943, il accepte de se produire, accompagné par l’orchestre de Fred Adison[14], autre gloire de l’époque, pour des ouvriers français requis par le STO près de Berlin. Il accepte de faire du cinéma sous l’autorité du Comité d’Organisation des Industries Cinématographiques qui régente la profession selon les principes “ positifs ” de la Propaganda Abteilung[15]. Pendant la guerre, l’auteur compositeur Trénet continue dans la même veine poétique, gaie, un brin surréaliste. Mais ses chansons semblent quitter le siècle et le temps : “ Que reste-t-il de nos amours? ”, “ La Romance de Paris ” ou “ L’Héritage infernal ” :
L’histoire lamentable
De fauteuils et de tables
Qu’un ami détestable
Vint raconter chez nous.
Il fait parfois de timides allusions à l’actualité. Quand il compose “ Les Oiseaux de Paris ”, les millions de Français qui ont souffert lors de l’évacuation savent qu’il évoque leur triste sort, même de manière biaisée. Sa seule chanson réellement engagée, “ Espoir ” est interdites sur les ondes de Radio-Paris. Il estime que pour mieux attendre demain il faut s’arracher du présent, créer une poésie atemporelle pour rendre la cruelle réalité supportable.
De la drôle de guerre à l’heure de la victoire, Maurice Chevalier se sera comporté en caméléon. Opportuniste, cherchant à tout instant d’où tournait le vent politique, il suit toutes les modes en en tirant le meilleur profit artistique. Dans la période de tous les dangers consécutive aux accords de Munich, Chevalier jouit de l’extraordinaire succès d’une chanson de 1936, insouciante et passablement vulguraire, apologie d’une oisiveté faubourienne, “ Ma Pomme ” (“ J’suis plus heureux qu’un roi ”). Il est, depuis le début des années vingt, une vedette internationale (il a tourné une quarantaine de films aux États-Unis), et il personnifie le brassage social qu’a occasionné la grande guerre : “ titi ” parisien originaire du quartier populaire de Ménilmontant, il s’est composé une silhouette élégante d’homme du monde (nœud papillon, costume impeccable). Mais son fameux canotier, qu’il porte sur le côté, connote le voyou qu’il a peut-être été dans sa jeunesse et rappelle le maquereau de sa chanson “ Prosper ”. L’image du prolo en smoking, parfaitement insouciant (il chante : « Dans la vie faut pas s’en faire » dans l’opérette Dédé) s’est donc imposée très facilement.
En 1939, il prône l’union sacrée dans “ Et tout ça, ça fait d’excellents français ”, une chanson au rythme entraînant, militaire, mais qui dépeint une société souffreteuse, contrainte de faire la guerre. Pendant la drôle de guerre, le président du Conseil Paul Reynaud assure que « nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts », et la bourse tient bon. De même que l’armée, prête et formidable, et qui, théoriquement, n’allait pas se risquer à de simples escarmouches. L’un des plus grands succès de l’hiver est une chanson que Maurice Chevalier interpréte au Casino de Paris, dépeignant l’armée comme le reflet de la société :
Le colonel était d’Action française,
Le commandant était un modéré,
Le capitaine était pour le diocèse,
Et le lieutenant boulottait du curé.
Le juteux était un fervent socialiste,
Le sergent un extrémiste[16] convaincu,
Le caporal inscrit sur toutes les listes
Et l’deuxième class’ au PMU.
Le colonel avait de l’albumine,
Le commandant souffrait du gros côlon,
Le capitaine avait bien mauvaise mine,
Et le lieutenant avait des ganglions.
Le juteux avait des coliques néphrétiques,
Le sergent avait le pylore atrophié,
Le caporal un coryza chronique,
Et l’deuxième class’ des corps aux pieds.
Et tout ça, ça fait
D’excellents Français,
D’excellents soldats
Qui marchent au pas.
Avec une telle armée, la mobilisation eut tôt fait de tourner à l’immobilisation générale. Une chanson réflétant le fait que 5 millions d’hommes avaient été rappelés – un quart de la population masculine – dont la plupart n’avait plus rien à faire après 5 heures de l’après-midi, et pas grand chose le reste de la journée. Chaque soldat avait droit à trois-quart de litres de vin par jour. Pour tous ces hommes, la Pologne ne représentaient rien et combattre pour la démocratie n’avait guère plus de sens. Ils se bornaient à accomplir leur devoir en espérant regagner leur foyer au plus vite. Chevalier dresse une typologie très partielle de la société française, composée à ses yeux de gens qui travaillent dans la finance, l’assurance, l’industrie, la Banque de France et la rente. Les paysans et les ouvriers qui constituent alors 80% de la population française sont donc exclus du tableau. Tous ces braves gens “ marchent au pas ” , mais sont affectés de maladies ridicules, albumine, pilore atrophié, ganglions, coliques néphrétiques, cors aux pieds. La chanson présente donc une armée vouée à la défaite mais qui saura se transcender grâce aux deux potions magiques que le monde entier envie aux Français : “ le pinard et le tabac ”. Cette chanson envoie donc un double message contradictoire : les Français ont réappris à marcher au pas et sont prêts à se battre, mais l’ensemble des appelés n’est qu’une cohorte de quadragénaires déglingués qui, de toute façon, « désirent tous désormais qu’on [leur] foutent une bonne fois la paix ». Bref, si Hitler écoute attentivement, il n’a guère de souci à se faire.
L’article 18 de l’armistice contraignait la France à payer 20 millions de marks par jour au titre des frais d’occupation de l’armée allemande. De nombreuses usines travaillaient directement pour Berlin. Les soldats allemands consommaient une bonne partie de la production alimentaire française (les tickets de rationnement donnaient droit à l’équivalent de 1500 calories par jour). C’est dans ce contexte de pénurie sans précédent que Maurice Chevalier crée en pleine guerre les “ Semelles de bois ” une chanson qui légitimise le pillage du pays. Il poétise l’inconfort pédestre auquel les femmes sont désormais condamnées :
J’aime le tap-tap
Des semelles en bois
En marchant les midinettes
Semblent faire des claquettes
Tap-tap la symphonie
Des beaux jours moins vernis
Et il termine même sur une touche franchement érotique : « Ah, qu’c’est bon! ».
La passivité, la complaisance de Chevalier déplaisent souverainement aux Français de Londres. En février 1944, Pierre Dac décrète qu’il sera « puni selon la gravité de ses fautes » :
« Quand, un jour prochain, nous leur ferons avaler leur bulletin de naissance, il est infiniment probable que la rigolade changera de camp et que, cette fois, il n’y aura pas de mou dans la corde à nœud. »[17]
Chevalier se demande alors s’il ne risque pas d’être condamné à mort[18]. Il se cache en Dordogne (le Périgord étant son Sigmaringen), où les maquis sont très actifs [19]. Il est arrêté, puis libéré grâce à sa compagne juive, Nita, qui l’emmène à Toulouse, la ville la plus “ rouge ” de France à ce moment-là :
« On s’y serait cru dans une ville espagnole pendant la guerre civile. Les rues étaient pleines de soldats en uniformes plus ou moins réguliers. Des jeunes femmes en mantilles priaient dans les églises; dans les cafés et dans les bureaux de la radio, les intellectuels parlaient de Paris, ville réactionnaire. » [20]
Chevalier en réchappera grâce, entre autres, à l’intervention de Louis Aragon. Il aura été jusqu’au bout un chanteur de consensus, inscrivant systématiquement ses chansons dans les normes dominantes, servant de caution populaire à l’ordre en vigueur.
[1] ORY, Pascal. “ L’histoire culturelle de la France contemporaine. Question et questionnement ”, Vingtième siècle. Revue d’histoire, n° 16, octobre-décembre 1987, p. 74.
[3] Berl résume dans sa personne les errements et les égarements de nombreux intellectuels français des années vingt aux années quarante. Issu d’une famille juive aisée, apparenté à Proust et à Bergson, il fut l’ami de Drieu la Rochelle avec qui il dirigea en 1927 l’éphémère revue Les Derniers Jours. Il publie en 1930 le très remarqué Mort de la pensée bourgeoise et collabore à Monde, le périodique de l’écrivain Henri Barbusse, proche du Parti Communiste. En 1932, il prend la direction de Marianne, revue culturelle et politique de gauche lancée par Gaston Gallimard. Il apprécie les avancées sociales du Front Populaire en 1936, mais il marque sa préférence pour les sentiments nationaux contre les revendications excessives. Il approuve la politique de non-intervention de Léon Blum dans la Guerre Civile Espagnole. Il fréquente le Tout-Vichy en 1940-41, vit en semi clandestinité à partir de 1942, craignant à juste titre les persécutions antisémites consécutives à l’invasion de la zone libre. Sa cousine ayant épousé Fernand de Brinon (délégué général du gouvernement de Vichy auprès des autorités d’occupation à Paris, condamné à mort et exécuté en 1947), il jouit d’une protection certaine. Il était le mari de la chanteuse Mireille (“ Couchés dans le foin ”).
[4] Dans ces mémoires, Chevalier expose, penaud, comment les Allemands ont exploité son manque de résolution : « La direction de Radio Paris [station entièrement contrôlée par les Allemands] me fait convoquer :
— Nous désirons que vous fassiez des émissions artistiques à Radio Paris comme vous en avez toujours fait à la Radio Française…
[…] Je sais trop bien ce qu’un refus catégorique me vaudrait par la suite. Il faut tergiverser, composer : ‘ Je ne puis rester que quelques semaines à Paris, vous comprenez, ma famille est dans le midi. ’ Je rougis un peu, l’homme me fixe. Je pense m’en être tiré intelligemment. Ne pas les mettre en boule contre moi, tout en faisant comprendre aux Français, par mon court séjour à Paris, que je ne fais que ce qui est absolument obligatoire. » Maurice Chevalier. Ma Route et mes chansons. (Paris, René Julliard, 1950) 309.
[5] Léo Marjane fut la créatrice de l’énorme succès “ Je suis seule ce soir ” (1942). La version masculine fut popularisée par André Claveau, le “ Prince de la chanson de charme ”. Les deux millions de prisonniers français en connaissaient par cœur le refrain :
Je suis seul ce soir
avec mes rêves.
Je suis seul ce soi
sans ton amour.
A la Libération, il fut reproché à Léo Marjane de s’être produite sur les antennes de Radio Paris et dans des cabarets devant des officiers allemands. « Je suis myope », répondra-t-elle devant la Chambre Civique et au Comité d’Epuration en 1945.
[6] Dans les années vingt et trente, les échanges culturels entre les deux pays avaient été très substantiels, la France exerçant sur l’art populaire allemand (chanson, cinéma) un fort attrait. Dès les années vingt, Maurice Chevalier et Mistinguett s’étaient produits avec grand succès en Allemagne. Le film allemand Bel Ami, écrit d’après la chanson de Tino Rossi, elle-même inspirée de Maupassant, avait connu la célébrité à la fin des années trente.
[7] Une première version de “ Lily Marlène ” vit le jour en 1915, suivie d’une seconde en 1935, d’une troisième en 1937 et d’une quatrième en 1939, toutes sans le moindre succès. Un soir de 1941, la chanson fut diffusée, dans une version de L. Andersen, par une station militaire allemande installée à Belgrade. Du jour au lendemain, “ Lily Marlène ” devint le plus grand succès de la guerre et fut considérée comme le second hymne national allemand.
[8] Berteaut, Simone. Piaf. (Paris : Robert Laffont, 1969), p. 209.
[1] Voir Paxton, Robert. La France de Vichy. (Paris : Le Seuil, 1973), chap. 4.
[10] À noter cependant que les nazis ont longtemps toléré en Allemagne certaines expressions culturelles théoriquement honnies comme le jazz, musique “ nègre ” ou la comédie musicale d’inspiration nord-américaine. En France, Alix Combelle et son orchestre avaient enregistré une version de “ In the Mood ” (“ Ambiance ”) en 1941.
[11] Le “ Chant des partisans ” sera enregistré magnifiquement par Yves Montand en 1955. Voir C. Brunschwig (et al.). Cent ans de chanson française. (Paris : Le Seuil, 1981) 88.
[12]
[13] Né à Narbonne en 1917, Trénet fut la cible d’antisémites délirants; Accusé de s’appeler Netter (anagramme de Trénet) et d’être petit-fils de juif, il dut produire un fort complet arbre généalogique pour prouver son “ aryanité ”. Lucien Rebatet, écrivain collaborationniste de choc, trouvait que Charles Trénet ressemblait aux « clowns judéo-américains ».
[14] Chef d’orchestre français (de son vrai nom Albert Lapeyre, né à Bordeaux en 1918) influencé par les orchestres de jazz symphoniques (comme celui de Paul Whiteman).
[15] Deux cent vingts longs métrages ont été réalisés pendant la guerre, dont deux bonnes dizaines de très grands films. Trente et un films français seront produits par la Continental, filiale de la société allemande U.F.A.
[16] Cela aurait certainement écorché son palais si Chevalier avait dû prononcer le mot “ communiste ”.
[17] DAC, Pierre. Un Français libre à Londres en guerre. Paris : France-Empire, 1972.
[18] CHEVALIER, Maurice. Ma route et mes chansons. Paris : Julliard, 1946.
[19] André Malraux a combattu dans cette région à cette époque.
[20] HUGO, Jean. Le Regard de la mémoire. Arles : Actes Sud, 1984.
SOURCES /
https://blogs.mediapart.fr/bernard-gensane/blog/120913/la-chanson-francaise-sous-l-occupation-allemande-une-douteuse-cohabitation
http://bernard-gensane.over-blog.com