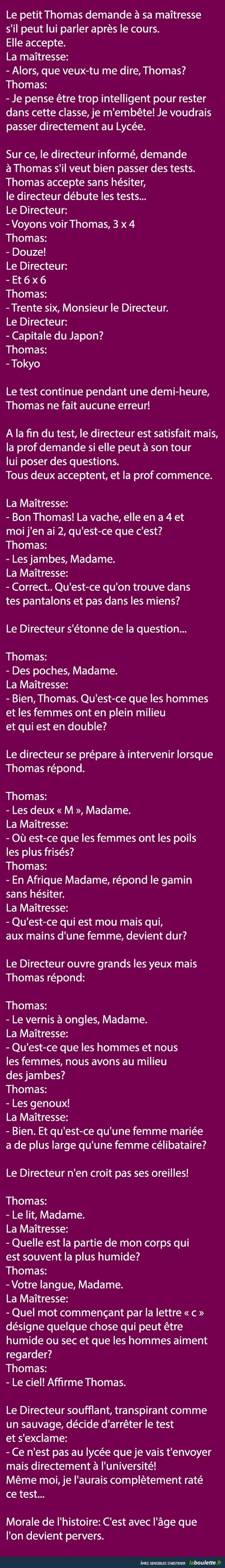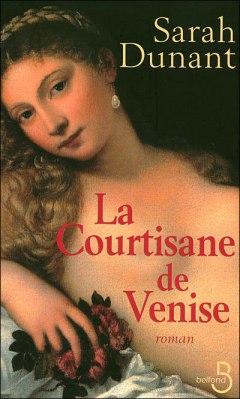Danses et Bals pendant la Guerre de Sécession

(Chronique Victorienne par Mrs A.A.C.
– Article publié dans le courrier d’Amérique n°65
- Le courrier d'Amérique est une revue diffusée par le CCFF)


Les années 1861-1865 ne furent pas que sang et boue, mort et destruction. A l’arrière (et parfois même à proximité immédiate du front !) se trouvaient encore grâce et beauté, illuminations et danses…
Bien avant la guerre civile, la danse est sans doute une des activités de loisir la plus répandue et la plus prisée par tous en Amérique.
Jeunes et vieux, riches et pauvres, citadins et ruraux, du nord et du sud, tous se retrouvent dans les innombrables bals, plus ou moins formels, organisés à travers le pays.
Le bal à une signification importante dans la vie sociale, c’est l’opportunité de côtoyer « physiquement » des personnes du sexe opposé dans un lieu public et peut-être, de faire des connaissances.

Au cours de la guerre civile , un bal est un excellent endroit pour oublier, au moins pour une soirée, la cruauté du temps.
Chaque grand événement est généralement l’occasion d’un bal , les investitures du président Lincoln en 1861 et 1864, celle du président Davis en 1861 par exemple.

En fait, il n’y a pas qu’à « l’arrière » que l’on danse. Pendant ce conflit, il est fait mention de nombreux bals, spontanés ou non, près des camps militaires ou parfois à l’intérieur même de ces campements. « Nous avons un bal presque chaque nuit » écrit un soldat de new York en octobre 1861 près de Washington, « les dames sont incarnées par des soldats ».
La proximité d’une localité amie (mais pas toujours !) incite à l’organisation de telles festivités ou les militaires comptent bien profiter de la présence, toujours fort appréciée, des représentantes du beau sexe.

Et quand ces dernières viennent à manquer , les soldats n’hésitent jamais à se partager entre « messieurs » et « dames » et dansent alors ensemble ! Ainsi au printemps 1864, à Brandy Station (Virginie) un bal fut-il organisé par les soldats du Massachussetts, devant le manque évident de coopération des dames sudistes des environs, les plus jeunes soldats s’habillèrent de costumes féminins !

Une grange est un lieu idéal pour ce genre de distraction, et l’on verra même quelques ennemis invités à partager les réjouissances pour un soir.
Souvent les autorités militaires ne sont pas les dernières pour l’organisation d’un bal, généralement associé à un événement notable (revues, célébrations diverses, visites de hauts personnages…)

Loin d’être un frein à la tenue de bals dans le pays, la guerre va au contraire les multiplier, ajoutant aux simples plaisirs de la convivialité et de la distraction, des mobiles patriotiques ou charitables . Même aux pires moments on ne cessera de danser dans les villes assiégées du sud ! (lire à ce sujet l’article « la belle vie dans le sud pendant la guerre civile » dans le « Courrier de la guerre d’Amérique » N° 54 ou sur internet http://hometown.aol.com/ccffpa/page17.html)

A l’exception des bals « militaires » les plus improvisés (mais on peut aussi s’y amuser à « singer » les usages en vigueur ailleurs) , les autres bals sont soumis à de nombreuses règles et une stricte étiquette . On peut considérer ces usages comme des contraintes , mais le décorum et la bienséance qui en découlent vont créer une ambiance , perdue au XXIe siècle, et agréablement désuète.

Au cours des années de la guerre de sécession, on peut distinguer trois types de bals ou les règles en vigueur diffèrent sensiblement.
Avant de nous pencher sur chacun d’eux, il convient d’évoquer , tout d’abord, sans doute une des choses les plus importantes dans la conscience de classe des gens du XIXe siècle, les « présentations ». Il n’y a à cette époque, peu ou pas de « mélange social » entre personnes issues des différentes couches de la société , et de toutes manières, jamais sans présentation officielle préalable.
Celle ci est faite lorsque qu’un ami vous présente une personne nouvelle avec votre permission. Cette « cérémonie » vous autorise ensuite à reconnaître, parler, visiter, demander assistance à cette personne, et, le plus important pour notre propos, un « gentleman » est dès lors autorisé à inviter une « lady » à danser ! Il est bien attendu que c’est TOUJOURS l’homme qui invite la femme dans un bal au cours des années 1860 ...à la condition expresse de savoir danser !!

Notons que la présentation donne rarement lieu à une poignée de mains, mais plutôt un bref salut;
1- Les bals privés :
Ils ont lieu sur invitation (plus ou moins officielle), sont limités souvent à la famille et aux amis proches, ou aux membres d’une organisation quelconque (politique, fraternelle, sociale, d’affaires…). Dans une telle soirée, tout le monde est considéré de façon égale et de bonne compagnie.

Tout homme peut inviter toute femme à danser, même si la présentation officielle n’a pas été faite auparavant (dans la réalité, les présentations sont effectuées de façon systématique au début du bal). Les dames ne peuvent qu’accepter , sauf engagement préalable ou grande fatigue.
Décliner une invitation en jugeant le cavalier inacceptable pour une raison ou une autre est considéré comme une insulte pour l’hôte ou l’hôtesse car cela impliquerait qu’un homme
qui n’est pas un gentleman a été invité au bal !
Les manuels d’étiquette du temps exigent de la dame qu’elle accepte l’invitation même si elle doit ensuite passer le reste de la soirée à éviter l’individu en question …

2- Les bals publics :
Ils sont ouverts à toute personne s’acquittant du prix du billet d’entrée. De tels bals sont extrêmement courants durant la guerre civile, servant, dans les deux camps, à soutenir l’effort de guerre ou collecter des fonds pour une multitude de justes causes (blessés, orphelins...) Mais on peut trouver des thèmes plus anodins, le « bal des célibataires » ou le « bal du printemps » ... Ils peuvent être annoncés par voix d’affiche ou dans la presse. Dans un bal public, si un homme a été présenté officiellement à une dame (avant ou pendant la soirée) il peut l’inviter. Dans le cas contraire, il a deux options:
Il connaît quelqu’un qui connaît la dame, il se renseigne discrètement sur ses chances et se fait présenter . Ou il demande l’assistance d’un « floor manager » pour obtenir une partenaire.
Les « floor managers » assistent le « dance master » la conduite d’un bal , particulièrement en veillant à ce que les danses comptent toujours le nombre de participants nécessaire.
Les « floor managers » jugeront rapidement le cavalier potentiel d’après ses manières, son langage, son costume, afin de lui fournir une cavalière appartenant à sa classe sociale.
L’homme est alors présenté à la dame (pour la danse seulement !) , celle-ci est tenue d’accepter sauf engagement précédent ou fatigue (elle a toujours une « porte de sortie »…)

3- Les bals « Maitres-serviteurs » :
Ces bals sont issus d’une ancienne tradition européenne ou le « seigneur » local donne un bal pour ses serviteurs et employés (parfois aussi les habitants du cru).
Quelques riches employeurs américains perpétuèrent cette coutume pour leurs employés agricoles
ou leurs ouvriers.
On pourrait penser qu’ici au moins, les classes sociales se trouvent brassées, le maître dansant sans façon avec sa servante… Ce n’est qu’apparence, car si tout le monde est effectivement réuni dans une même salle , il y a probablement très peu d’interaction entre les classes.
Une variation des règles régissant le bal privé est ici appliquée.

Tout homme peut inviter toute femme mais seuls les « supérieurs » peuvent inviter les « inférieurs », jamais le contraire.
Ainsi , le maître des lieux dansera bien avec sa servante mais le garçon d’écurie n’a aucune chance de la faire avec la dame de la maison .
A noter que les mêmes restrictions s’appliquent aux bals militaires mêlant officiers, sous-officiers et hommes de troupe. Un « supérieur » invitera une dame « inférieure » à danser mais pas le contraire, à moins que le supérieur n’ai donné son accord préalable à son subordonné.
Dans l’Amérique « égalitaire » toutes les femmes sont cependant des « ladies » alors que traditionnellement , dans l’armée britannique ou l’on trouve d’abord ce genre de bal, seules les femmes d’officiers ont droit à ce titre, les sous-officiers ont des « épouses » (wifes), les soldats, des « femmes » (women).
4- Invitation et saluts :
Nous savons désormais qui invite qui et dans quelle circonstance. Voyons à présent comment se déroule cette invitation. Là encore, les règles sont strictes mais peuvent subir des variantes localement . Nous avons vu qu’une « lady » (puisque toutes les femmes le sont donc) n’invitait jamais un homme à danser , cependant, si elle a un cavalier particulier « en vue », la dame peut passer par un intermédiaire , un ami qui suggérera discrètement au gentleman en question de venir faire son invitation…

Un homme désireux de danser avec une femme mariée ira , le plus souvent, demander la permission au mari avant de présenter sa requête à la dame.
En présentant son invitation, le gentleman s’incline , la dame accepte par une petite révérence si elle est debout, un signe de tête si elle est assise.
Une femme mariée ne se lèvera pour remercier que si l’homme est considérablement plus élevé qu’elle dans la hiérarchie sociale (politicien de haut rang, officier supérieur, clergyman, hôte d’honneur…).

La dame peut tendre sa main mais plus l’événement est public , moins les mains se touchent ! Les jeunes filles se lèveront toujours quel que soit le cavalier qui les invite mais ne donneront jamais leur main. Signalons que les « vieilles filles » d’un certain age adopteront le comportement de la femme mariée.
La formule de l’invitation est
« Will you honor me for a dance » (voudriez-vous m’honorer d’une danse) ou encore « will you honor me with your hand » (voudriez-vous m’honorer de votre main ».
Le « will you honor me for the pleasure of a dance » (voudriez-vous m’honorer du plaisir d’une danse , ou « Will you give me the pleasure of dancing » (voudriez vous me donner le plaisir de danser) sont des formules plus anciennes mais encore usitées dans les milieux moins sophistiqués).

Le gentleman escorte alors la Lady vers la « piste » puis, à sa place après la danse (ou à quelque endroit qu’elle le demande, au buffet pour se rafraîchir par exemple) .
Il remerciera la dame pour l’honneur qu’elle vient de lui faire en s’inclinant, le « baise-main » n’est pas mentionné dans les manuels d’étiquette de la période de la guerre civile
et ne se pratiquait donc certainement pas.

La dame ne doit pas remercier son cavalier pour la danse, un sourire ou un petit mouvement de tête répondront au « merci » masculin.

Il est convenable pour l’homme de converser un instant avec la lady avant de la quitter, par contre il est inconvenant d’inviter la dame assise juste à coté d’elle pour la prochaine danse ! (dans le cas ou une dame refuse votre invitation, ne tentez pas non plus votre chance avec sa voisine …

5- Bonnes manières générales :
Les messieurs ne doivent jamais oublier que les dames doivent passer avant toute chose , elles doivent bénéficier des meilleures chaises, des places d’honneur…
Le cavalier doit toujours être agréable avec la dame , sourire, même en dansant et
ne pas se montrer crispé outre mesure.

De la même façon, la dame doit se considérer comme « engagée » vis à vis de son cavalier et lui réserver son attention et sa conversation en évitant les sourires aux autres hommes de l’assistance par exemple !
Dans un bal public, une lady ne paiera JAMAIS une boisson , c’est bien sûr à son cavalier du moment de le faire pour elle !
On dansera tranquillement, sans sauter ou taper des pieds de manière brutale et toute querelle dans une salle de bal est bien entendu proscrite ! Comme le sont toute parole vulgaire ou inconvenante.
La chute d’un couple sur la piste de danse est une chose rare,
mais dans ce cas, le fautif est TOUJOURS le cavalier !!!

La main ou la taille d’une dame ne doit jamais être pressée mais délicatement effleurée. D’ailleurs, les mains des messieurs, comme des dames, doivent être gantées (il est même recommandé de prévoir deux paires de gants au cas ou la première serrait souillée.)
Il faut, bien sûr, ne jamais oublier un engagement ni inviter une cavalière à la hâte alors que la danse va débuter (notons que le carnet de bal n’existe pas aux Etats-Unis, les dames peuvent cependant noter leurs engagements sur leur éventail souvent en papier.)

6- Le bal, organisation :
Le nombre des invités ou des participants à un bal doit être proportionnel à la grandeur de la salle ou il se déroule (mais ce peut-être une grange ou à l’extérieur…).

Cette salle sera de préférence large et presque carrée mais pas tout à fait afin de pouvoir accueillir deux quadrilles en même temps , ce qui n’est pas vraiment praticable dans une pièce carrée.

Les pièces longues et étroites sont, elles, à proscrire !
Bien sûr, un beau parquet est le meilleur des sols si il n’est pas glissant.

On veillera à la lumière et la ventilation qui doivent être présents en suffisance.
Bien sûr, un orchestre fournit la musique.
De taille variable il peut même n’être composé que de deux musiciens.
Dans les bals militaires, ce sont les « fanfares » (military bands) qui fournissent la musique.

Les invitations à un bal sont faites au nom de la dame de la maison (pour un bal privé) et doivent être envoyées au moins dix jours avant la soirée prévue.
Trois semaines ou un mois sont même autorisés. Les invités ont deux à trois jours, pas plus , pour répondre. Il faut également veiller à équilibrer les participants entre dames et messieurs afin que chacun puisse participer et profiter au mieux de la soirée.
Une pièce devra être réservée aux dames (avec plusieurs miroirs) pour qu’elles puissent arranger coiffures et robes.
Un vestiaire pour les manteaux et châles est souhaitable.

Dans le cas d’un bal masqué ou surtout costumé (possible dans les trois types de bal cités plus haut), il faudra aussi prévoir une salle , ou plusieurs, ou les invité(e)s pourront se changer.

Une autre pièce sera prévue pour les rafraîchissements , si cet arrangement n’est pas possible, il faudra les faire circuler entre les danses .
Un bal peut être précédé, ou interrompu momentanément, par un souper ou un buffet selon qu’il s’agisse d’une soirée privée ou publique.
7- Le bal, déroulement :
A cette époque, un bal débute assez tard selon les critères d’aujourd’hui. Les invités doivent avoir accompli leurs tâches quotidiennes, être rentrés chez eux, s’être changés et il leur faut un certain temps pour parvenir à l’endroit ou se déroule le bal (particulièrement à la campagne) , les moyens de transport étant assez lents. Ainsi un bal public commencera généralement entre 9 heures et 11 heures du soir pour durer jusqu’à l’aube.
La première chose à faire en arrivant à un bal est de se rendre au vestiaire. Le gentleman ne manquera pas de mettre ses gants si ce n’est déjà fait puis il attendra la dame qu’il escorte ou accompagne. Celle-ci se prépare de son coté, échangeant en particulier ses souliers de ville pour des chaussons de danse. Le gentleman escortant une lady devra, au cours de la soirée, toujours veiller à ce qu’elle ne manque de rien, à lui procurer des rafraîchissements, à l’accompagner lorsqu’elle se déplace dans la salle de bal et bien sûr, à l’escorter à nouveau au moment du départ.
A l’entrée des invités, l’hôte est responsable des indispensables présentations ou l’on ne se serrera JAMAIS les mains. L’hôte (ou le « dance master ») , veillera à ce que toutes les dames désireuses de danser puissent trouver un cavalier. Il est à souligner que l’on attend instamment des messieurs qui se rendent à un bal qu’ils DANSENT et souvent ! Il est impoli de danser plus d’une fois (au pire, deux) avec la même partenaire au cours de la soirée (évidemment si l’assistance est vraiment peu nombreuse , difficile de faire autrement) et particulièrement avec son épouse, en règle générale, ladies et gentlemen doivent éviter de danser avec les mêmes personnes afin de faire partager le plaisir de la danse à tous les invités.
8- Caractéristiques du bal 1860 :
Nous arrivons à un point capital au sujet du bal au milieu du XIXe siècle, son aspect d’activité SOCIALE. On croit aujourd’hui, et ceci est du en grande partie à la vision souvent déformée que nous en ont donné le grand et le petit écran, qu’un bal en 1860 se résume à une série de danses effectuées par des couples, évoluant sur une piste au milieu d’autres danseurs sans plus d’interaction entre eux . Cette forme de bal s’imposera certes progressivement au cours de la seconde moitié du XIXe siècle pour finalement devenir la règle à la fin de celui-ci et au début du XXe siècle. A l ‘époque de la guerre civile, un bal est essentiellement composé de « danses sociales » mettant en scène un groupe de personnes dans une suite variée d’évolutions en formation . En bref, on ne danse pas à deux mais toujours à plusieurs. Un bal typique du temps comptant deux douzaines de danses ne comprendra que deux ou trois danses de couple comme valse, polka, scottische ou mazurka. Le reste sera composé de quadrilles, reels, et d’autres danses effectuées en cercle, carré ou ligne ou l’on change constamment de cavalier et de cavalière , ou l’on côtoie perpétuellement les autres couples .
Cela ne signifie pas que les pas de valses, polkas etc… soient inutiles, ils sont généralement intégrés à des chorégraphies de groupe comme la valse espagnole par exemple.

Si la danse est une activité faisant partie du cérémonial de séduction, elle n’est pas envisagée comme quelque chose qui est réservé aux « amoureux » mais comme un moment d’échange. Danser et se mêler aux autres est un devoir social , c’est de cette façon que l’on doit l’envisager pour une reconstitution historique crédible en abandonnant les comportements et préjugés modernes et en adoptant ceux du milieu de l’époque Victorienne. Bon bal à toutes et tous!
Une liste non exhaustive de danses pour un bal « 1861-1865 » Avec la formation et le pas général :
Grand March : par couple, pas
Soldier’s joy : en ligne ou cercle de couples se faisant face, pas
Snowball reel : en ligne de dames face à ligne de messieurs, pas ou pas rapide
Federal Scottische : cercle de couples, pas de Scottische
Virginia Reel : Ligne de dames face à ligne de messieurs, pas ou pas rapide
German Waltz : cercle de couples, pas de valse
The tempest : Ligne de deux couples face à deux couples, pas ou pas rapide
Spanish waltz : Ligne ou cercle de couples, pas de valse
Quadrille : quatre couples en carré, pas et pas rapide
Il existe des variantes dans les quadrilles et les Reels
Valse : par couple, pas de valse
Galop : par couple, pas rapide
Scottische : par couple, pas de scottische
Polka : par couple, pas de polka
Mazurka : par couple, pas de mazurka
Polka mazurka : par couple, combinaison de polka et mazurka
Polka Redowa : par couple, variante de la polka
SOURCES
http://russon.alain.perso.neuf.fr/pages%20des%20adherents/bal/balcw.htm
 L’hétaïre était une prostituée de haut rang dans la Grèce antique. Les hétaïres ne se contentent pas d’offrir des services sexuels et leurs prestations ne sont pas ponctuelles : de manière littérale, ἑταίρα / hetaíra signifie « compagne ».
L’hétaïre était une prostituée de haut rang dans la Grèce antique. Les hétaïres ne se contentent pas d’offrir des services sexuels et leurs prestations ne sont pas ponctuelles : de manière littérale, ἑταίρα / hetaíra signifie « compagne ».