
Pour de pacifiques joutes




Des différentes périodes de l’Histoire, nous sommes plutôt familiers avec les modes de vie de la noblesse, de la bourgeoisie, des élites…
bref, des classes sociales les plus élevées.
Aussi, l’exposition qui a actuellement lieu au musée Carnavalet se charge-t-elle de rétablir un certain équilibre en évoquant la vie quotidienne du peuple qui représentait environ 2/3 des parisiens au XIXe siècle.

L’exposition s’ouvre en évoquant la Révolution française car c’est précisément à ce moment qu’est née la peur du peuple en même temps qu’une violente prise de conscience de son existence.
Qu’est-ce qui forge l’identité de ce peuple ?
Au XIXe siècle, le centre de Paris se situe autour de l’Hôtel de Ville. Il y a très peu de lumière (la fée électricité n’est pas encore passée par là), les immeubles sont bas (ils ne seront rehaussés que lors des grands travaux haussmanniens) et donnent sur des cours étroites dans lesquelles les habitants n’hésitent pas à jeter des déchets divers et variés.

Les épidémies sont fréquentes.
La population explose à travers une immigration massive qui trouve refuge dans la zone près de la Porte de Clignancourt
(à peu près au niveau des actuelles puces de Saint-Ouen).

Ce peuple exerce une multitude de métiers comme tondeur de chiens ou porteur d’eau
(en bas, à gauche sur la gravure).
Remarquez également ce que les habitants portent aux pieds :
des sabots, particulièrement résistants à l’usure.
Les petits ramoneurs sont particulièrement symboliques de cette migration professionnelle qui va et vient selon les saisons. Ce sont surtout les enfants, plus aptes à se faufiler dans les cheminées, qui exercent ce métier. Ils ne sont pas épargnés malgré leur jeune âge et doivent exercer des labeurs difficiles afin d’aider leurs familles à vivre.
C’est au XIXe siècle que la première enquête parlementaire voit également le jour avec toute une série de questions portant sur les conditions de travail.
Cependant, le questionnaire est adressé aux patrons ce qui fausse les données recueillies.

Parmi ces anciens métiers dont la plupart ont aujourd’hui disparu, nous découvrons le marchand de coco qui vendait de l’eau parfumée à la réglisse, le vitrier et son portoir (métier toujours en activité), la foire aux maçons sur la place de l’Hôtel de Ville ou encore les Forts des Halles qui étaient des manutentionnaires chargés de transporter les marchandises entre l’extérieur et l’intérieur des pavillons des Halles de Paris.
Afin de devenir « Fort », il fallait prouver sa force en transportant une charge de 200 kg sur 60 mètres sans aucune aide extérieure.
Les femmes exercent souvent un métier ayant trait à l’entretien du linge. La propreté est alors associée au blanc
(toiles de lin, de coton, de chanvre…) Sous le Second Empire,

il existe environ 70.000 blanchisseuses à Paris qui travaillent depuis leurs domiciles à la lumière du jour, parfaites représentantes du Sweating System (exploitation du prolétariat).
C’est un travail épuisant à l’image du tableau de Degas.
L’eau n’est pas propre car non traitée.
L’apparition de l’eau de javel en 1780 aide cependant à maintenir le blanc du linge et un semblant de propreté.
Le monde des ouvriers spécialisés est plus enviable car lié à des activités de luxe pour les classes supérieures.
Ainsi, les tabletiers garnisseurs ou les serruriers ont des modes de vie un peu plus confortables que la majorité du peuple.
Ils bénéficient d’un week-end de deux jours tout au long du XIXe siècle.
L’exposition s’attache ensuite à retracer la vie quotidienne du peuple au cours du XIXe siècle.
Les logements sont rares et de nombreuses activités s’organisent dans les cours d’immeubles.
C’est d’ailleurs ainsi que le métier de concierge verra le jour.
Ces cours sont pourtant des lieux insalubres :
il n’existe aucun système d’évacuation des eaux usées, celles-ci sont jetées depuis les fenêtres.
Cela entraîne de graves problèmes d’hygiène qui donnent lieu à de grandes épidémies (comme celle de choléra en 1832).
On peut découvrir quelques objets de la vie courante comme un petit réchaud à braises qui se trouve être également la seule source de chaleur du foyer. Les familles nombreuses s’entassent souvent dans une même pièce. On boit beaucoup de vin car il sert à la fois de reconstituant et de valeur sûre car non souillé contrairement à l’eau.
L’alcoolisme est très répandu, la population tiraillée par la faim comme nous allons le voir un peu plus loin.
La première cité ouvrière de Paris voit le jour en 1849
sur une idée de Napoléon III.
Elle n’aura guère de succès à cause d’un règlement interne draconien et des loyers très élevés.
Ces cités sont pourvues de toilettes, de salles de bain et d’un médecin. Ces luxes restent hors de portée pour une population majoritairement pauvre.
Les logements sont souvent pourvus du strict nécessaire. Ci-dessous un réchaud et un petit pot en terre pour la nourriture.
Dans une vitrine, le visiteur peut découvrir une paire de sabots cloutés. Les clous s’usent sur la chaussée, préservant le bois.
A côté, un bleu de travail qui évoque le monde des ouvriers.
Pour les femmes, un ensemble composé d’une chemise de jour, d’un corset et d’un jupon d’une blancheur étincelante.
Pourtant, l’hygiène des corps n’est pas une priorité : on se lave environ une fois par semaine en été et une fois par mois en hiver.
La criminalité est élevée notamment dans certains quartiers (Belleville, Ménilmontant, etc.)
Un tableau de pipes en terre attire l’attention. Il s’agit d’une collection d’objets ayant appartenus à des condamnés à mort.
Des notes donnent le nom du propriétaire et son attitude au cours de sa détention ou avant son exécution.

Pipes en terre et autres objets ayant appartenu à des condamnés à mort rassemblés par leur surveillant (1885)
Les pipes sont cassées le long de la tige, détail intrigant qui rappelle l’expression « casser sa pipe ».
J’ai effectué quelques recherches et j’ai découvert que cette expression serait née sous le Premier Empire pendant les guerres Napoléoniennes.
Sur les champs de bataille, les médecins militaires ne disposaient pas du matériel nécessaire pour anesthésier les soldats avant les amputations. En guise d’anesthésiant, on leur donnait une pipe à mordre afin d’éviter qu’ils ne crient.
Si le soldat succombait à ses blessures, il lâchait alors la pipe qu’il tenait entre ses mâchoires, et celle-ci se brisait en tombant.
Les pipes exposées auraient-elles été cassées afin de souligner la destinée funeste des condamnés à mort ?
Parmi les criminels dont les noms sont ici exposés figure celui de Billoir. Retenez-le bien car nous aurons l’occasion d’en reparler.
Même si les moments de repos sont rares, les Parisiens trouvent des occasions de s’amuser.
Les loisirs sont simples : la promenade
(on quitte alors le centre de Paris pour Montmartre), un pique-nique, un verre dans un cabaret ou quelques danses dans les guinguettes (dont le célèbre Moulin de la Galette).
Il y a alors une véritable fascination pour le spectacle au point d’organiser des journées gratuites pour le peuple.
Une salle est réservée à l’œuvre d’Honoré Daumier.
Fils de vitrier, il porte sur le peuple dont il est lui-même issu, un regard positif.
Il peint un peuple courageux et digne, plein de tendresse envers ses enfants.
On pourrait croire parfois qu’il critique le peuple en soulignant sa voracité ou ses mauvaises manières.
En réalité, il met l’emphase ici sur la faim qui tenaille les entrailles.
Les immeubles au XIXe siècle étaient recouverts de peinture au plomb. C’est ce qui donne à Paris un aspect d’une blancheur immaculée, en arrière plan de cette peinture.
Lorsqu’on découvrira l’aspect nocif du plomb, les façades seront modifiées mais le peuple se plaindra d’avoir perdu le blanc des immeubles.
La musique est également très appréciée, on le voit dans ce dessin à travers la fascination du petit garçon en habit de travail.
Les joueurs d’orgues servaient également de contacts à la police.
Mais Honoré Daumier était surtout connu pour ses lithographies et ses caricatures.
Le parcours se poursuit sur le thème de l’indigence. Les conditions de précarité sont telles que certaines personnes peuvent basculer dans la pauvreté en cas de maladie, d’accident ou de chômage. On fait alors appel au Mont-de-piété en engageant ses effets contre un peu d’argent. La population qui se rend au Mont-de-piété est très variée : ouvriers, grisettes, dandys désargentés…
Le plus souvent, on engageait son matelas pour une raison très simple : ceux-ci étaient systématiquement nettoyés et débarrassés des puces et autres vermines qui l’infestaient. Il suffisait de le récupérer quelques jours plus tard.
La figure du chiffonnier illustre bien cette précarité. Ceux-ci travaillent la nuit et inquiètent la police au point de devoir se faire référencer.
Au XIXe siècle, des piles de détritus dans les rues attendaient le passage des tombereaux au petit matin. Les chiffonniers récupéraient les chiffons mais également les os de boucherie. Les sucreries sont alors en pleine expansion et le sucre est extrait du raisin et de la betterave. Coloré à l’origine, on blanchit ce sucre en le filtrant avec de l’os calciné… ou du sang de cheval.
Les chiffonniers récupéraient également la suie et les boîtes en métal pour la fabrication des jouets. En 1883, M. Poubelle mettra leur activité en danger. On autorisera alors les chiffonniers à fouiller les piles dans les rues une heure seulement.
Les abandons d’enfants sont légion car les mères n’ont pas les moyens de les garder. Ils sont déposés à l’assistance publique.
Devant les couvents, on trouve une petite porte qu’on ouvre avant de déposer les nouveau-nés dans un tour d’abandon, on sonne une cloche pour prévenir de son « dépôt » avant de s’enfuir dans la nuit. Les orphelins sont pris en charge par l’Eglise puis mis dehors dès qu’ils sont en âge de se débrouiller seuls. Livrés à eux-mêmes, ces enfants sombrent très rapidement dans la délinquance.
Parallèlement, la philanthropie se développe ce qui n’est pas sans nous rappeler certains passages de Germinal (Cécile étranglée par le père Maheu alors qu’elle vient faire la charité avec ses parents) ou des Misérables (la visite de Jean Valjean et Cosette aux Thénardiers).
La dernière salle évoque à nouveau le danger que représente le peuple aux yeux des classes supérieures. La peur du crime va augmenter au cours du XIXe siècle. Peur qui s’accompagne d’une certaine fascination jusqu’à l’âge d’or du fait divers à la Belle Epoque.
C’est dans ce contexte que nous retrouvons le nom de Baptiste-Joseph Billoir dans l’affaire du crime de Saint-Ouen. Cet homme avait en effet assassiné sa compagne, une bretonne nommée Jeanne-Marie Le Manach, avant de la dépecer et de balancer les restes dans la Seine. Cette affaire, comme celle de l’incendie du Bazar de la Charité attirera de nombreuses personnes à la morgue qui viendront « en visite ».
On évoque également les barricades qui ont jalonnées le siècle : l’issue des trois Glorieuses de 1830, de février et juin 1848 et de la Commune en 1871 qui furent réprimées dans le sang. Dernière image de l’exposition : un bourgeois qui demande du feu à un chiffonnier sous les yeux amusées d’un témoin. Deux mondes qui se croisent, aux antipodes l’un de l’autre, sans vraiment se rencontrer. Ou la parfaite illustration de la lutte des classes.
Repères chronologiques
 1785-1790 : édification de l’enceinte des Fermiers généraux.
1785-1790 : édification de l’enceinte des Fermiers généraux.  1791 : lois d’Allarde et Le Chapelier supprimant les corporations et interdisant toute association.
1791 : lois d’Allarde et Le Chapelier supprimant les corporations et interdisant toute association.  1801 : création des Hospices civils de Paris.
1801 : création des Hospices civils de Paris.  1808 : création des dépôts de mendicité, interdiction de mendicité dans le département de la Seine.
1808 : création des dépôts de mendicité, interdiction de mendicité dans le département de la Seine.  27-29 juillet 1830 : insurrection parisienne (Les « trois Glorieuses ») et installation de la monarchie de Juillet.
27-29 juillet 1830 : insurrection parisienne (Les « trois Glorieuses ») et installation de la monarchie de Juillet.  1832 : épidémie de choléra à Paris (décès de 1 habitant sur 46).
1832 : épidémie de choléra à Paris (décès de 1 habitant sur 46).  1841-1846 : construction de l’enceinte dite de Thiers.
1841-1846 : construction de l’enceinte dite de Thiers.  23-25 février 1848 : révolution, proclamation de la deuxième République, puis (23-26 juin 1848) nouvelle insurrection et répression.
23-25 février 1848 : révolution, proclamation de la deuxième République, puis (23-26 juin 1848) nouvelle insurrection et répression.  1850 : loi sur l’hygiène publique.
1850 : loi sur l’hygiène publique.  1853 : Haussmann, préfet de la Seine, entreprend de grands travaux à Paris.
1853 : Haussmann, préfet de la Seine, entreprend de grands travaux à Paris.  1860 : Paris s’agrandit et passe de 12 à 20 arrondissements.
1860 : Paris s’agrandit et passe de 12 à 20 arrondissements.  1864 : reconnaissance du droit de grève.
1864 : reconnaissance du droit de grève.  18 mars - 28 mai 1871 : révolte de la Commune de Paris contre le gouvernement de la 3ème République.
18 mars - 28 mai 1871 : révolte de la Commune de Paris contre le gouvernement de la 3ème République.  1884 : reconnaissance de la liberté syndicale.
1884 : reconnaissance de la liberté syndicale.  1892-1894 : vague d’attentats anarchistes à Paris.
1892-1894 : vague d’attentats anarchistes à Paris.  1893 : loi sur l’hygiène du travail.
1893 : loi sur l’hygiène du travail.  1898 : loi sur les accidents de travail.
1898 : loi sur les accidents de travail.  1901 : reconnaissance de la liberté d’association.
1901 : reconnaissance de la liberté d’association.  1906 : loi sur le repos hebdomadaire, accordé aux salariés hormis les gens de maison et les concierges.
1906 : loi sur le repos hebdomadaire, accordé aux salariés hormis les gens de maison et les concierges.










Danses et Bals pendant la Guerre de Sécession

(Chronique Victorienne par Mrs A.A.C.
– Article publié dans le courrier d’Amérique n°65
- Le courrier d'Amérique est une revue diffusée par le CCFF)


Les années 1861-1865 ne furent pas que sang et boue, mort et destruction. A l’arrière (et parfois même à proximité immédiate du front !) se trouvaient encore grâce et beauté, illuminations et danses…
Bien avant la guerre civile, la danse est sans doute une des activités de loisir la plus répandue et la plus prisée par tous en Amérique.
Jeunes et vieux, riches et pauvres, citadins et ruraux, du nord et du sud, tous se retrouvent dans les innombrables bals, plus ou moins formels, organisés à travers le pays.
Le bal à une signification importante dans la vie sociale, c’est l’opportunité de côtoyer « physiquement » des personnes du sexe opposé dans un lieu public et peut-être, de faire des connaissances.

Au cours de la guerre civile , un bal est un excellent endroit pour oublier, au moins pour une soirée, la cruauté du temps.
Chaque grand événement est généralement l’occasion d’un bal , les investitures du président Lincoln en 1861 et 1864, celle du président Davis en 1861 par exemple.

En fait, il n’y a pas qu’à « l’arrière » que l’on danse. Pendant ce conflit, il est fait mention de nombreux bals, spontanés ou non, près des camps militaires ou parfois à l’intérieur même de ces campements. « Nous avons un bal presque chaque nuit » écrit un soldat de new York en octobre 1861 près de Washington, « les dames sont incarnées par des soldats ».
La proximité d’une localité amie (mais pas toujours !) incite à l’organisation de telles festivités ou les militaires comptent bien profiter de la présence, toujours fort appréciée, des représentantes du beau sexe.

Et quand ces dernières viennent à manquer , les soldats n’hésitent jamais à se partager entre « messieurs » et « dames » et dansent alors ensemble ! Ainsi au printemps 1864, à Brandy Station (Virginie) un bal fut-il organisé par les soldats du Massachussetts, devant le manque évident de coopération des dames sudistes des environs, les plus jeunes soldats s’habillèrent de costumes féminins !

Une grange est un lieu idéal pour ce genre de distraction, et l’on verra même quelques ennemis invités à partager les réjouissances pour un soir.
Souvent les autorités militaires ne sont pas les dernières pour l’organisation d’un bal, généralement associé à un événement notable (revues, célébrations diverses, visites de hauts personnages…)

Loin d’être un frein à la tenue de bals dans le pays, la guerre va au contraire les multiplier, ajoutant aux simples plaisirs de la convivialité et de la distraction, des mobiles patriotiques ou charitables . Même aux pires moments on ne cessera de danser dans les villes assiégées du sud ! (lire à ce sujet l’article « la belle vie dans le sud pendant la guerre civile » dans le « Courrier de la guerre d’Amérique » N° 54 ou sur internet http://hometown.aol.com/ccffpa/page17.html)

A l’exception des bals « militaires » les plus improvisés (mais on peut aussi s’y amuser à « singer » les usages en vigueur ailleurs) , les autres bals sont soumis à de nombreuses règles et une stricte étiquette . On peut considérer ces usages comme des contraintes , mais le décorum et la bienséance qui en découlent vont créer une ambiance , perdue au XXIe siècle, et agréablement désuète.

Au cours des années de la guerre de sécession, on peut distinguer trois types de bals ou les règles en vigueur diffèrent sensiblement.
Avant de nous pencher sur chacun d’eux, il convient d’évoquer , tout d’abord, sans doute une des choses les plus importantes dans la conscience de classe des gens du XIXe siècle, les « présentations ». Il n’y a à cette époque, peu ou pas de « mélange social » entre personnes issues des différentes couches de la société , et de toutes manières, jamais sans présentation officielle préalable.
Celle ci est faite lorsque qu’un ami vous présente une personne nouvelle avec votre permission. Cette « cérémonie » vous autorise ensuite à reconnaître, parler, visiter, demander assistance à cette personne, et, le plus important pour notre propos, un « gentleman » est dès lors autorisé à inviter une « lady » à danser ! Il est bien attendu que c’est TOUJOURS l’homme qui invite la femme dans un bal au cours des années 1860 ...à la condition expresse de savoir danser !!

Notons que la présentation donne rarement lieu à une poignée de mains, mais plutôt un bref salut;
1- Les bals privés :
Ils ont lieu sur invitation (plus ou moins officielle), sont limités souvent à la famille et aux amis proches, ou aux membres d’une organisation quelconque (politique, fraternelle, sociale, d’affaires…). Dans une telle soirée, tout le monde est considéré de façon égale et de bonne compagnie.

Tout homme peut inviter toute femme à danser, même si la présentation officielle n’a pas été faite auparavant (dans la réalité, les présentations sont effectuées de façon systématique au début du bal). Les dames ne peuvent qu’accepter , sauf engagement préalable ou grande fatigue.
Décliner une invitation en jugeant le cavalier inacceptable pour une raison ou une autre est considéré comme une insulte pour l’hôte ou l’hôtesse car cela impliquerait qu’un homme
qui n’est pas un gentleman a été invité au bal !
Les manuels d’étiquette du temps exigent de la dame qu’elle accepte l’invitation même si elle doit ensuite passer le reste de la soirée à éviter l’individu en question …

2- Les bals publics :
Ils sont ouverts à toute personne s’acquittant du prix du billet d’entrée. De tels bals sont extrêmement courants durant la guerre civile, servant, dans les deux camps, à soutenir l’effort de guerre ou collecter des fonds pour une multitude de justes causes (blessés, orphelins...) Mais on peut trouver des thèmes plus anodins, le « bal des célibataires » ou le « bal du printemps » ... Ils peuvent être annoncés par voix d’affiche ou dans la presse. Dans un bal public, si un homme a été présenté officiellement à une dame (avant ou pendant la soirée) il peut l’inviter. Dans le cas contraire, il a deux options:
Il connaît quelqu’un qui connaît la dame, il se renseigne discrètement sur ses chances et se fait présenter . Ou il demande l’assistance d’un « floor manager » pour obtenir une partenaire.
Les « floor managers » assistent le « dance master » la conduite d’un bal , particulièrement en veillant à ce que les danses comptent toujours le nombre de participants nécessaire.
Les « floor managers » jugeront rapidement le cavalier potentiel d’après ses manières, son langage, son costume, afin de lui fournir une cavalière appartenant à sa classe sociale.
L’homme est alors présenté à la dame (pour la danse seulement !) , celle-ci est tenue d’accepter sauf engagement précédent ou fatigue (elle a toujours une « porte de sortie »…)

3- Les bals « Maitres-serviteurs » :
Ces bals sont issus d’une ancienne tradition européenne ou le « seigneur » local donne un bal pour ses serviteurs et employés (parfois aussi les habitants du cru).
Quelques riches employeurs américains perpétuèrent cette coutume pour leurs employés agricoles
ou leurs ouvriers.
On pourrait penser qu’ici au moins, les classes sociales se trouvent brassées, le maître dansant sans façon avec sa servante… Ce n’est qu’apparence, car si tout le monde est effectivement réuni dans une même salle , il y a probablement très peu d’interaction entre les classes.
Une variation des règles régissant le bal privé est ici appliquée.

Tout homme peut inviter toute femme mais seuls les « supérieurs » peuvent inviter les « inférieurs », jamais le contraire.
Ainsi , le maître des lieux dansera bien avec sa servante mais le garçon d’écurie n’a aucune chance de la faire avec la dame de la maison .
A noter que les mêmes restrictions s’appliquent aux bals militaires mêlant officiers, sous-officiers et hommes de troupe. Un « supérieur » invitera une dame « inférieure » à danser mais pas le contraire, à moins que le supérieur n’ai donné son accord préalable à son subordonné.
Dans l’Amérique « égalitaire » toutes les femmes sont cependant des « ladies » alors que traditionnellement , dans l’armée britannique ou l’on trouve d’abord ce genre de bal, seules les femmes d’officiers ont droit à ce titre, les sous-officiers ont des « épouses » (wifes), les soldats, des « femmes » (women).
4- Invitation et saluts :
Nous savons désormais qui invite qui et dans quelle circonstance. Voyons à présent comment se déroule cette invitation. Là encore, les règles sont strictes mais peuvent subir des variantes localement . Nous avons vu qu’une « lady » (puisque toutes les femmes le sont donc) n’invitait jamais un homme à danser , cependant, si elle a un cavalier particulier « en vue », la dame peut passer par un intermédiaire , un ami qui suggérera discrètement au gentleman en question de venir faire son invitation…

Un homme désireux de danser avec une femme mariée ira , le plus souvent, demander la permission au mari avant de présenter sa requête à la dame.
En présentant son invitation, le gentleman s’incline , la dame accepte par une petite révérence si elle est debout, un signe de tête si elle est assise.
Une femme mariée ne se lèvera pour remercier que si l’homme est considérablement plus élevé qu’elle dans la hiérarchie sociale (politicien de haut rang, officier supérieur, clergyman, hôte d’honneur…).

La dame peut tendre sa main mais plus l’événement est public , moins les mains se touchent ! Les jeunes filles se lèveront toujours quel que soit le cavalier qui les invite mais ne donneront jamais leur main. Signalons que les « vieilles filles » d’un certain age adopteront le comportement de la femme mariée.
La formule de l’invitation est
« Will you honor me for a dance » (voudriez-vous m’honorer d’une danse) ou encore « will you honor me with your hand » (voudriez-vous m’honorer de votre main ».
Le « will you honor me for the pleasure of a dance » (voudriez-vous m’honorer du plaisir d’une danse , ou « Will you give me the pleasure of dancing » (voudriez vous me donner le plaisir de danser) sont des formules plus anciennes mais encore usitées dans les milieux moins sophistiqués).

Le gentleman escorte alors la Lady vers la « piste » puis, à sa place après la danse (ou à quelque endroit qu’elle le demande, au buffet pour se rafraîchir par exemple) .
Il remerciera la dame pour l’honneur qu’elle vient de lui faire en s’inclinant, le « baise-main » n’est pas mentionné dans les manuels d’étiquette de la période de la guerre civile
et ne se pratiquait donc certainement pas.

La dame ne doit pas remercier son cavalier pour la danse, un sourire ou un petit mouvement de tête répondront au « merci » masculin.

Il est convenable pour l’homme de converser un instant avec la lady avant de la quitter, par contre il est inconvenant d’inviter la dame assise juste à coté d’elle pour la prochaine danse ! (dans le cas ou une dame refuse votre invitation, ne tentez pas non plus votre chance avec sa voisine …

5- Bonnes manières générales :
Les messieurs ne doivent jamais oublier que les dames doivent passer avant toute chose , elles doivent bénéficier des meilleures chaises, des places d’honneur…
Le cavalier doit toujours être agréable avec la dame , sourire, même en dansant et
ne pas se montrer crispé outre mesure.

De la même façon, la dame doit se considérer comme « engagée » vis à vis de son cavalier et lui réserver son attention et sa conversation en évitant les sourires aux autres hommes de l’assistance par exemple !
Dans un bal public, une lady ne paiera JAMAIS une boisson , c’est bien sûr à son cavalier du moment de le faire pour elle !
On dansera tranquillement, sans sauter ou taper des pieds de manière brutale et toute querelle dans une salle de bal est bien entendu proscrite ! Comme le sont toute parole vulgaire ou inconvenante.
La chute d’un couple sur la piste de danse est une chose rare,
mais dans ce cas, le fautif est TOUJOURS le cavalier !!!

La main ou la taille d’une dame ne doit jamais être pressée mais délicatement effleurée. D’ailleurs, les mains des messieurs, comme des dames, doivent être gantées (il est même recommandé de prévoir deux paires de gants au cas ou la première serrait souillée.)
Il faut, bien sûr, ne jamais oublier un engagement ni inviter une cavalière à la hâte alors que la danse va débuter (notons que le carnet de bal n’existe pas aux Etats-Unis, les dames peuvent cependant noter leurs engagements sur leur éventail souvent en papier.)

6- Le bal, organisation :
Le nombre des invités ou des participants à un bal doit être proportionnel à la grandeur de la salle ou il se déroule (mais ce peut-être une grange ou à l’extérieur…).

Cette salle sera de préférence large et presque carrée mais pas tout à fait afin de pouvoir accueillir deux quadrilles en même temps , ce qui n’est pas vraiment praticable dans une pièce carrée.

Les pièces longues et étroites sont, elles, à proscrire !
Bien sûr, un beau parquet est le meilleur des sols si il n’est pas glissant.

On veillera à la lumière et la ventilation qui doivent être présents en suffisance.
Bien sûr, un orchestre fournit la musique.
De taille variable il peut même n’être composé que de deux musiciens.
Dans les bals militaires, ce sont les « fanfares » (military bands) qui fournissent la musique.

Les invitations à un bal sont faites au nom de la dame de la maison (pour un bal privé) et doivent être envoyées au moins dix jours avant la soirée prévue.
Trois semaines ou un mois sont même autorisés. Les invités ont deux à trois jours, pas plus , pour répondre. Il faut également veiller à équilibrer les participants entre dames et messieurs afin que chacun puisse participer et profiter au mieux de la soirée.
Une pièce devra être réservée aux dames (avec plusieurs miroirs) pour qu’elles puissent arranger coiffures et robes.
Un vestiaire pour les manteaux et châles est souhaitable.

Dans le cas d’un bal masqué ou surtout costumé (possible dans les trois types de bal cités plus haut), il faudra aussi prévoir une salle , ou plusieurs, ou les invité(e)s pourront se changer.

Une autre pièce sera prévue pour les rafraîchissements , si cet arrangement n’est pas possible, il faudra les faire circuler entre les danses .
Un bal peut être précédé, ou interrompu momentanément, par un souper ou un buffet selon qu’il s’agisse d’une soirée privée ou publique.
7- Le bal, déroulement :
A cette époque, un bal débute assez tard selon les critères d’aujourd’hui. Les invités doivent avoir accompli leurs tâches quotidiennes, être rentrés chez eux, s’être changés et il leur faut un certain temps pour parvenir à l’endroit ou se déroule le bal (particulièrement à la campagne) , les moyens de transport étant assez lents. Ainsi un bal public commencera généralement entre 9 heures et 11 heures du soir pour durer jusqu’à l’aube.
La première chose à faire en arrivant à un bal est de se rendre au vestiaire. Le gentleman ne manquera pas de mettre ses gants si ce n’est déjà fait puis il attendra la dame qu’il escorte ou accompagne. Celle-ci se prépare de son coté, échangeant en particulier ses souliers de ville pour des chaussons de danse. Le gentleman escortant une lady devra, au cours de la soirée, toujours veiller à ce qu’elle ne manque de rien, à lui procurer des rafraîchissements, à l’accompagner lorsqu’elle se déplace dans la salle de bal et bien sûr, à l’escorter à nouveau au moment du départ.
A l’entrée des invités, l’hôte est responsable des indispensables présentations ou l’on ne se serrera JAMAIS les mains. L’hôte (ou le « dance master ») , veillera à ce que toutes les dames désireuses de danser puissent trouver un cavalier. Il est à souligner que l’on attend instamment des messieurs qui se rendent à un bal qu’ils DANSENT et souvent ! Il est impoli de danser plus d’une fois (au pire, deux) avec la même partenaire au cours de la soirée (évidemment si l’assistance est vraiment peu nombreuse , difficile de faire autrement) et particulièrement avec son épouse, en règle générale, ladies et gentlemen doivent éviter de danser avec les mêmes personnes afin de faire partager le plaisir de la danse à tous les invités.
8- Caractéristiques du bal 1860 :
Nous arrivons à un point capital au sujet du bal au milieu du XIXe siècle, son aspect d’activité SOCIALE. On croit aujourd’hui, et ceci est du en grande partie à la vision souvent déformée que nous en ont donné le grand et le petit écran, qu’un bal en 1860 se résume à une série de danses effectuées par des couples, évoluant sur une piste au milieu d’autres danseurs sans plus d’interaction entre eux . Cette forme de bal s’imposera certes progressivement au cours de la seconde moitié du XIXe siècle pour finalement devenir la règle à la fin de celui-ci et au début du XXe siècle. A l ‘époque de la guerre civile, un bal est essentiellement composé de « danses sociales » mettant en scène un groupe de personnes dans une suite variée d’évolutions en formation . En bref, on ne danse pas à deux mais toujours à plusieurs. Un bal typique du temps comptant deux douzaines de danses ne comprendra que deux ou trois danses de couple comme valse, polka, scottische ou mazurka. Le reste sera composé de quadrilles, reels, et d’autres danses effectuées en cercle, carré ou ligne ou l’on change constamment de cavalier et de cavalière , ou l’on côtoie perpétuellement les autres couples .
Cela ne signifie pas que les pas de valses, polkas etc… soient inutiles, ils sont généralement intégrés à des chorégraphies de groupe comme la valse espagnole par exemple.

Si la danse est une activité faisant partie du cérémonial de séduction, elle n’est pas envisagée comme quelque chose qui est réservé aux « amoureux » mais comme un moment d’échange. Danser et se mêler aux autres est un devoir social , c’est de cette façon que l’on doit l’envisager pour une reconstitution historique crédible en abandonnant les comportements et préjugés modernes et en adoptant ceux du milieu de l’époque Victorienne. Bon bal à toutes et tous!
Une liste non exhaustive de danses pour un bal « 1861-1865 » Avec la formation et le pas général :
Grand March : par couple, pas
Soldier’s joy : en ligne ou cercle de couples se faisant face, pas
Snowball reel : en ligne de dames face à ligne de messieurs, pas ou pas rapide
Federal Scottische : cercle de couples, pas de Scottische
Virginia Reel : Ligne de dames face à ligne de messieurs, pas ou pas rapide
German Waltz : cercle de couples, pas de valse
The tempest : Ligne de deux couples face à deux couples, pas ou pas rapide
Spanish waltz : Ligne ou cercle de couples, pas de valse
Quadrille : quatre couples en carré, pas et pas rapide
Il existe des variantes dans les quadrilles et les Reels
Valse : par couple, pas de valse
Galop : par couple, pas rapide
Scottische : par couple, pas de scottische
Polka : par couple, pas de polka
Mazurka : par couple, pas de mazurka
Polka mazurka : par couple, combinaison de polka et mazurka
Polka Redowa : par couple, variante de la polka
SOURCES
http://russon.alain.perso.neuf.fr/pages%20des%20adherents/bal/balcw.htm
|
Comme dans toutes les guerres, les soldats des deux camps se trouvèrent au cours de la guerre de sécession, privés de leurs compagnes pour une longue période. La nature étant ce qu'elle est, ils cherchèrent naturellement un palliatif à cette absence. Le moyen le plus simple restait encore le recours aux "professionnelles de l'amour" et on peut affirmer, sans se tromper, que la sexualité des soldats de la guerre civile américaine fut satisfaite avant tout par la prostitution.
Au nord comme au sud, celle ci prit des proportions jusqu'alors jamais atteintes lors d'un conflit, mais cette guerre n'est t'elle pas précisément faites de "premières" ?
Surnommées "filles faciles", "filles de joie" ou encore "filles de petite vertu", ces femmes venus dans l'Ouest américain pour pratiquer le plus vieux métier du monde sont les premières dames de "l'American Frontier", les pionnières de l'Ouest. Les pionniers de l'Ouest américain étaient à la recherche d'or. Vivant dans des villes minières, ils ont rapidement attiré de nombreuses prostituées. Bagarre, jeux, alcools, elles ont subit la violence des hommes. Si certaines sont encore connues aujourd'hui, beaucoup sont mortes dans l'indifférence et dans la pauvreté. A travers les portraits des plus célèbres d'entre elles, ce film nous permet de cerner la réalité de leur difficile vie.
Concernées avant tout: Les grandes villes. Washington compte 450 "bordels" répertoriés en 1862, (mais on en découvre de nouveaux tous les jours !) dont "Fort Sumter", "the Ironclad", "the blue goose" etc... et 5 000 prostituées en 1863 (contre 500 en 1860 !), plus 2 500 dans les villes voisines de Georgetown et Alexandria, décrite comme "une parfaite Sodome", sans compter les filles entretenues que des officiers font parfois passer pour leur épouse !!! . Un reporter, Franc B.Wilkie décrira avec dégoût son séjour à Washington à l'automne 1862 :
« c'est le trou le plus pestilentiel depuis Sodome et Gomorrhe .
La majorité des femmes dans les rues sont ouvertement de mauvaise vie… Les officiers ivres y sont en nombre suffisant pour prendre Richmond mais préfèrent les bars, les maisons de jeu et les maisons closes aux champs de bataille. »
Dans la capitale fédérale, un quartier entier, "Murder bay" (appelé aussi "Hooker's division"), est voué à la prostitution.
|
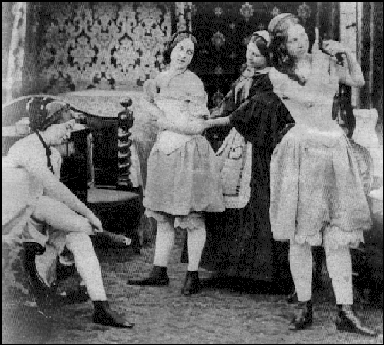
|
Puisque nous en parlons, le nom du général Hooker (ci-contre LC) reste lié à la prostitution même si le terme "hookers" désignant à la fois prostituées et beuveries était déjà employé bien avant la guerre.
Par une amusante coïncidence, Hooker s'intéresse justement fortement au problème, ("payant" de sa personne dit on) et pense que la présence de femmes dans les camps serait bonne pour le moral des troupes. "Nous sommes les filles de Hooker" s'exclament en guise de laissez-passer, les prostituées conduites dans les cantonnements fédéraux à la veille de la bataille de Chancellorsville en mai 1863.
Un officier de cavalerie du Massachussetts dira de Hooker : « Quand il avait le commandement, le quartier général de l'armée du Potomac n'était pas un endroit pour un homme respectable et aucune femme décente n'y avait sa place. C'était un mélange de bar louche et de bordel » . |
 |

|
En 1864, les autorités de Washington (qui restent bien impuissantes devant le phénomène malgré "raids" et amendes) classent 85 "maisons" (ou l'on vend le plus souvent de l'alcool illégalement), selon leur "qualité", des meilleures (N° 1) dans les beaux quartiers aux "pires" (N°3 ou sans numéro du tout !), on trouve même un certain nombre de "bordels" proposant exclusivement des filles de couleur !
Le private Haydon note en novembre 1861 qu'on trouve trois types de gens dans la capitale: les soldats,
" les deux autres grandes classes sont les politiciens et les prostituées, très nombreux et égaux en quantité, en honnêteté et en moralité. "
Pendant la guerre, on y trouve au moins 8 000 prostituées. En 64/65, 2 000 filles hantent les rues et les "bordels " de Chicago.
Baltimore, Boston, Cincinnati, St Louis ne sont pas en reste. "Nous avons du bon temps ici, une garde de temps en temps et une fille toutes les nuits"
(C.Hopkins, près de Cairo, Illinois, avril 1864).
se transforment en lieux de débauche, souvent quelques semaines seulement après l'entrée des fédéraux (quand elles ne le sont pas déjà bien entendu, les "maisons" de Bourbon street a la Nouvelle Orléans "fonctionnaient" fort bien avant la venue des soldats bleus !!! !) .
Un officier de l'Ohio écrit que
"Memphis est maintenant une des places principales de la prostitution féminine du continent. La vertu n'est plus connue qu'en dehors de ses limites."
"]e suis de garde presque tous les jours parce qu'il y a tellement de mauvais lieux ici que nous devons placer une sentinelle devant chaque porte pour maintenir l'ordre" (Samuel Jarrett à Savannah, janvier 1865).
Notons que certaines choisiront tout de même de suivre les rebelles en retraite, ou, restant sur place, afficheront sans retenue leur patriotisme, allant jusqu'à faire de la contrebande ou même assassiner des soldats ennemis... |
 |
Quand les autorités fédérales de Washington laissèrent libre passage aux femmes qui désiraient rejoindre le sud (ici leur embarquement , LC), 600 choisirent de partir . Parmi-elles au moins 70 prostituées . |
|
City Point en Virginie est une importante base fédérale pendant le conflit: "le diable est dans la place. I1 y a une cité entière de putains. Oui père, une cité entière !" (Un employé de la "Sanitary commission" à sa famille, fin 1864). Si cela choque ce jeune homme, d'autres (les plus nombreux ?) ne s'en plaignent pas "Nous n'avons rien à faire ici à part baiser, et on le fait abondamment !" (F.R.Lyman, 1864) !!!
Les soldats profitent parfois de leur "auréole de libérateur" auprès des prostituées noires, très appréciées pour "l'exotisme":
"Elles tombent amoureuses de nous pensant que nous allons les emmener vers la liberté et elle ne nous font pas payer !" note avec satisfaction un yankee stationné à Memphis !
La Nouvelle Orléans, Mobile, Dalton(Géorgie), très réputée pendant les campagnes d'Atlanta et Chattanooga (Johnston tentera d'y intervenir sans grand succès):
"I1 me parvient quotidiennement des plaintes concernant les nombreuses femmes de mauvaise vie de cette ville" écrit un officier du QG de l'armée du Tennessee à l'été 1864
"Elles pullulent dans l'entourage immédiat des quartiers de nos soldats et ont des relations avec presque tous ceux ci. Des vols sont commis dans nos dépôts pour payer leurs services." .
|
|
Mais c'est la capitale de la Confédération, Richmond qui emporte la palme. Petite ville provinciale promue capitale, Richmond a vu sa population passer de 40 000 à 100 000 personnes en deux ans ! "Une métropole boursouflée par le vice" dit le journal 1'Examiner".
Dans les faubourgs de l'ouest, "Screamerville" (la ville des hurlements) n'est qu'une suite ininterrompue de saloons, de bordels et autres lieux louches.
Une de ces "maisons de vice" va jusqu'à s'installer en face d'un des plus importants hôpitaux militaires, et les "propositions » (gestes a l'appui !) fusent au dessus de la rue et des passantes respectables vers les soldats convalescents !!! µ
Un auteur a estimé qu'en ces années la, Richmond contenait plus de prostituées de toutes catégories, que la Nouvelle-Orléans et Paris réunies ! |
|
|
Une carte de visite « d'actrice » pendant la guerre , carte qui peut tout aussi bien servir de publicité à une prostituée notoire ! Le genre de photos dont étaient friands les soldats de la guerre civile ... |
|
En janvier 1864, un journal de Cincinnati affirme que les "filles de joie" sont près d'avoir éliminé totalement les femmes décentes des promenades publiques.
Ces "dames" étant souvent bien mieux vêtues que les vraies Ladies, on se pose des questions sur l'efficacité du blocus ...
On a beau s'indigner, tenter de chasser les "Cyprians", de les incarcérer, voire de les "refiler" aux "copains d'en face", rien n'y fait ...
"Les nymphes du monde sont depuis toujours nécessaires aux grandes armées car elles en sont une émanation" explique le "Daily Inquirer" de Richmond.
Rien de neuf sous le soleil !
La pauvreté, I'alcool, le veuvage même, peuvent faire glisser bien des femmes sur la pente du "vice".
Cinq "filles" de Culpeper furent arrêtées un jour à Richmond, au cours de leur interrogatoire, deux d'entre elles affirmèrent avoir perdu leur époux dans les rangs de I'armée Confédérée.
On ne les en traita pas mieux pour cela, personne ne semblant prêter attention à ce genre de déclaration.
Le 30 avril 1861, une jeune fille de 16 ans fut arrêtée à Boston, racolant dans la rue.
Elle était couturière mais ne gagnait pas assez pour nourrir sa mère.
On pourrait multiplier les exemples de ce genre que le temps de guerre aggrave encore, particulièrement dans le sud ou des milliers de femmes connaissent le triste sort des réfugiés de toutes les époques: la perte de leur foyer, l'errance, souvent avec des enfants, la misère, la faim Comment s'étonner que beaucoup ne trouvent que dans le commerce de leur corps, les ressources nécessaires pour continuer a subsister ? |
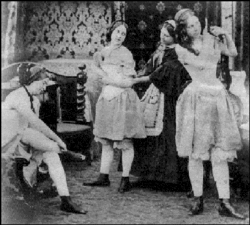 |
Des « dames » dans leur boudoir . Pour ce genre de photographies « osées » , on recourait souvent au service de prostituées dans les studios ... |
|
Dès lors, la prostitution ne se rencontre plus seulement dans les grandes villes, mais dans toutes les agglomérations et encore plus généralement dans toutes les zones, urbaines ou rurales ou l'on trouve des soldats ou des troupes en marche. "Cette partie du pays abonde en femmes de mauvaise vie" (Sgt Vairin, CSA, 27/12/1862, Caroline du nord), "La moitié des femmes des environs, mariées ou célibataires, ont perdu leur respectabilité. "(Capitaine Key, CSA, 2/1/1864, ligne Georgie-Tennessee), "La vertu des femmes, si elle a jamais existé dans ce pays, semble maintenant avoir totalement fait naufrage. Les prostituées sont partout: |
|
dans les montagnes, les vallées, dans les hameaux et les cités. Je suppose que l'influence des armées a largement contribué à cet état de fait; les soldats ne semblent pas ressentir les mêmes restrictions loin de chez eux, ce qui régularisait auparavant leurs relations avec le beau sexe." (Major Mims, CSA, fin 1863, Tennessee de I'Est).
II semble aussi que la prostitution n'hésitait pas à aller chercher les hommes jusque dans leurs campements si nécessaire: "Plusieurs fois par semaine, notre poste est visité par deux soeurs qui se vendent…
Quelquefois elles emmènent une négresse avec elles..." (H.Levin, 2nd Virginia réserves, fin 1864).
En avril 65, H.P.Hennon (87th Pennsylvanie) écrit que ses copains ont trouvé une vieille prostituée près d'un ponton, derrière une pile de tabac: "Tom tenait la lampe et elle reçu soixante grosses bites l'une après l'autre. ]'étais mort de rire et la sacrée vieille pute tenait bon". !!! Au début du conflit, un soldat confédéré remarquait qu'en plus des épouses et soeurs d'officiers et des cuisinières et lavandières, on trouvait aussi "ici et là une dame élégante et maniérée, touchante dans sa solitude, mais manquant du seul passeport de respectabilité pour une femme dans un camp: les liens du mariage" (I.Gibbons, 8/1862). Des "Cyprians », de haut vol ? A rapprocher du témoignage du soldat Haydon (US) notant le 25/5/1861 la visite de quelques jolies dames cherchant dans le camp des "frères" et des "cousins:
"Elles étaient belles, c'est sur, mais les gars avaient tellement peu d'argent qu'à moins que l'amour soit plus fort que l'avarice, les discussions se terminaient de façon peu satisfaisante".
Il semble que les lavandières n'ai pas toujours été irréprochables non plus si I'on en croit le soldat Olmanson du Minnesota en novembre 61: « Nous avons environ quarante femmes. dans le régiment, plusieurs font beaucoup d'argent par des voies naturelles..."
|
|
Le plus souvent, rien ou presque ne distinguait une prostituée d'une femme honnête quand on la croisait dans la rue. De « première classe » elles suivaient la mode , de « deuxième choix », elles étaient vêtues comme les femmes de la campagne ou les ouvrières. L'image de la prostituée aguicheuse se promenant en « dessous » aux abords des camps de l'armée est totalement erronée. La plupart du temps, les filles devaient opérer discrètement et donc , éviter d'attirer l'attention des autorités sur leur personne ... |
 |
|
Les prostituées aussi suivent la mode: "Elles se pavanaient dans leurs crinolines en se déhanchant. nos gars ont eu beaucoup de bon temps avec elles. », (Private Philipps, 92° Illinois).
"Le colonel avait suivi plusieurs soldats qui se dissimulaient en allant dans le bois. S'approchant de 1'en droit, il vit deux dames en jupons et crinolines se livrant à un commerce lucratif; il resta et regarda suffisamment longtemps pour satisfaire sa curiosité..." (un soldat du.4° Maryland Rgt, octobre 1863).
L'encombrant accessoire que constitue la crinoline reste un élément de séduction. même dans l'exercice du plus vieux métier du monde !
Après l'évacuation précipitée de l'Ile N° 10 par les sudistes sur le Mississippi, les unionistes découvrent dans les positions rebelles:
« Un essaim de nymphes. les cheveux défaits, les bustes délacés. le camp portant toutes les marques de la féminité avec des crinolines et des pantalons de dessous suspendus aux arbres et les bagages des officiers confédérés mêlés aux calicos."
Et encore: En mars 65, un parti yankee avait chassé un poste confédéré de White's tavern :
"et découvert que nous avions interrompu une "partie".
La petite était au lit, prête, payée mais inutilisée, nous étions trop gentlemen pour laisser une "dame" dans une telle détresse..."
(Cite par T.Lowry, "sex in CW"). Visiblement les consignes étaient très souples !!!
" Si tu pouvais te trouver là en ces occasions, tu penserais qu'il n'y a pas un homme marié dans tout le régiment à part moi (ben voyons ! NDLR). Beaucoup le sont pourtant..."
Et si parfois le règlement était plus stricte, ces "dames" trouvaient des astuces pour continuer leurs "affaires" en s'installant près du camp et débauchant les sentinelles par exemple:
Deux pauvres gars sont ainsi exécutes pour abandon de poste dans le Tennessee, écrit le major Mims, CSA, à sa femme, ils avaient succombés aux charmes de "professionnelles".
Le soldat Collins du Michigan provost guard, reçut dix jours au pain et à l'eau pour avoir eu des relations avec une prostituée alors qu'il était de garde à Détroit en mai 1863...Le lieutenant Parrott ( 16th Illinois) est privé de six mois de solde pour avoir eu des relations sexuelles avec une prostituée noire alors qu'il commandait un poste de garde dans le Tennessee en décembre 1862.
Le colonel Anglais Freemantle cite le cas d'une femme en uniforme gris, croisée dans un train non loin d'Atlanta en 1863 et expulsée de l'armée du Tennessee, elle avait été chassée pour sa conduite immorale malgré sa participation à plusieurs batailles.
En septembre 1864, "1'Enquirer" de Richmond expose les cas semblables de Mary et Mollie Bell (alias Tom Parker et Bob Morgan), une "Canadian Lou" en uniforme fédéral est arrêtée en état d'ébriété à Memphis en décembre 1862, le soldat Bear du 116th Illinois parle de son lieutenant qui garde près de lui une certaine Kate, portant l'uniforme "Quelques gars de la compagnie aimeraient avoir un "accrochage" dans le camp avec elle. On peut difficilement en parler comme d'un homme..." ...etc. |
|
Difficile cependant de faire la différence entre prostituées ou concubines en uniforme et femmes soldats aux mobiles plus patriotiques. ou affectifs .
Que penser de ce "sergent" US qui accouche dans l'armée de Rosecrans et ceci "en complète violation des lois militaires" note ce dernier ou de cet "officier" sudiste qui met au monde un gros garçon dans la prison de Johnson Island en décembre 1864 ? "Sans doute une femme" note le perspicace reporter du "Sandusky register", certes, mais prostituée ou pas ? Miss Massey dans son "Bonnet brigade" pense que la majorité des femmes en uniforme étaient des "filles", c'est aller beaucoup trop loin et les historiens d'aujourd'hui qui s'intéressent à elles ne partagent absolument pas cet avis.
On peut lire dans le Newark Daily Advertiser du 31/5/1864: " Les autorités militaires de Washington montrent que 150 femmes ont déjà été découvertes dans l'armée. » Curieusement, plus de soixante dix servaient comme "aide de camp" d'officiers au moment de leur découverte. Dans un régiment, il y avait dix sept de ces femmes portant pantalons et sack coats au lieu de calicos et crinolines. |
|
|
|
|
Le général US James C.Rice s'entoure d'un essaim de jolies femmes dans son QG de Redwood près de Culpeper (Va), il les appellent ses « nonnes » ! Une certaine Annie Jones, se vante d'avoir été « l'invitée » des généraux Sigel, Stahel, Custer et Kilpatrick . Ce dernier aimait assurément s'entourer de jeunes dames à la vertu douteuse .
Il est vu , ainsi que le général Estes, en compagnie d'un « Charley » et d'un « Franck » qui sous leurs uniformes se révéleront être des femmes . Kilpatrick semble également avoir eu un faible pour une « Molly » et une « Alice » qu'il présentait comme une institutrice qu'il escortait vers le nord , « On croyait généralement dans le commandement qu'il l'avait avec lui pour des motifs moins honorables » (J.Miller 5th Ohio cavalry). On notera que la seule mention de prostitution masculine à l'époque se trouve dans le numéro du 13 mai 1862 du "Richmond dispatch", condamnant la "vulgarité des prostitués des deux sexes" dans les rues de la capitale sudiste…
Bien évidemment, la conséquence inévitable de cette prostitution galopante fut la prolifération de maladies "sexuellement transmissibles", aggravée par le manque d'hygiène et la presque totale ignorance de la médecine de l'époque en la matière.
Pour une nuit avec « Vénus », le soldat risquait de passer toute sa vie avec « Mercure » (le mercure était le traitement le plus commun contre les maladies vénériennes à l'époque). Des statistiques de l'armée fédérale portant sur 468 275 soldats blancs entre mai 61 et juin 66 donnent 182 779 cas de maladies vénériennes (73 382 cas de Syphilis, 109 397 de Gonorrhée) dont 136 mortels.
Entre juin 1864 et juin 1866 sur 63 645 soldats de couleur, 14 257 sont infectes, 32 trouvent la mort.
Un statisticien du département médical de !'Union a calculé que lors de la première année du conflit, un yankee sur douze souffrait d'une maladie "honteuse" et que pour la période entière de la guerre, le taux était de 82 pour 1000.
Coté confédéré, on admet généralement que les maladies vénériennes firent moins de ravages du fait des ressources moindres des soldats (moins d'occasions d'aller voir les filles, alors que les recrues et les vétérans de !'Union qui se rengageaient se trouvaient avoir les poches pleines de dollars) et des séjours des troupes beaucoup plus prolongés en rase campagne plutôt qu'a proximité des cités.
Mais, on l'a vu, des prostituées, on en trouvait partout, et puis on pouvait très souvent "payer en nature" plutôt qu'en argent, alors il est bien difficile d'en tirer des conclusions, d'autant que les archives sudistes sont loin d'être complètes sur ce sujet là aussi...
|
 |
Photographie de l'Hôpital N°11 a Nashville, traitant les prostituées atteintes de maladies vénériennes. On pense d'habitude qu'il s'agit des lavandières attachées à l'établissement, mais d'après l'historien, j. Hoobler, le personnel étant exclusivement noir, les femmes blanches sur ce cliché seraient plus certainement des prostituées de la ville en cours de traitement. |
|
Quelques chiffres partiels montreront tout de même que les rebelles aussi étaient touchés: En juillet 61, pour 12 régiments représentant 11 452 hommes, on signale 204 nouveaux cas de Gonorrhée et 44 de syphilis.
En aout pour 29 unités et 27 042 soldats, 152 nouveaux cas de Gonorrhée et 102 de syphilis. En septembre, 38 régiments regroupant 33 284 hommes ajoutent 148 cas de plus pour la première maladie, et 70 pour la seconde. etc...
Ensuite, la discipline prenant le dessus, les infections régressent (sans disparaître), mais reprennent largement dès que les troupes cantonnent près d'une cité.
Les micro organismes responsables de la syphilis et de la gonorrhée ne seront identifiés respectivement qu'en 1905 et 1879. Les traitements adéquats ne seront mis au point qu'en 1910 et 1945 !!!
Alors en 1860, les remèdes sont. ce qu'ils sont et leur efficacité des plus douteuses, si la maladie peut être jugulée, on reste au mieux, contagieux, mais souvent la mort est au bout, ce n'est qu'une question de temps
On ne saura jamais combien de soldats rentrant de la guerre ont infectés leur femme ou leur fiancée, ni les effets désastreux de ces maladies sur les enfants nés atteints du mal...
|
|
Quelques chiffres partiels montreront tout de même que les rebelles aussi étaient touchés:
En juillet 61, pour 12 régiments représentant 11 452 hommes, on signale 204 nouveaux cas de Gonorrhée et 44 de syphilis.
En aout pour 29 unités et 27 042 soldats, 152 nouveaux cas de Gonorrhée et 102 de syphilis.
En septembre, 38 régiments regroupant 33 284 hommes ajoutent 148 cas de plus pour la première maladie, et 70 pour la seconde. etc...
Au nord comme au sud, les premiers mois de la guerre se montreront redoutables en ce domaine pour des milliers et des milliers de jeunes hommes tout juste arrivés de leurs campagnes et confrontés à la proximité des grandes villes et de leurs inévitables tentations.
Ensuite, la discipline prenant le dessus, les infections régressent (sans disparaître), mais reprennent largement dès que les troupes cantonnent près d'une cité. Les micro organismes responsables de la syphilis et de la gonorrhée ne seront identifiés respectivement qu'en 1905 et 1879.
Les traitements adéquats ne seront mis au point qu'en 1910 et 1945 !!!
Alors en 1860, les remèdes sont. ce qu'ils sont et leur efficacité des plus douteuses, si la maladie peut être jugulée, on reste au mieux, contagieux, mais souvent la mort est au bout, ce n'est qu'une question de temps
On ne saura jamais combien de soldats rentrant de la guerre ont infectés leur femme ou leur fiancée, ni les effets désastreux de ces maladies sur les enfants nés atteints du mal...
Après une "croisière" peu agréable de 28 jours (lire ci-dessous) , la plupart des filles regagnèrent Nashville et se remirent au "travail". |
| Le curieux voyage de l'Idaho : En juillet 1863, le général Rosecrans réquisitionna un nouveau navire de transport de passagers, l'Idaho, du capitaine Newcomb. On ordonna à ce dernier de transporter toutes les prostituées de Nashville jusqu'à Louisville. Newcomb protesta mais dut embarquer les 111 filles que l'on rafla dans la ville. Sans escorte militaire et avec seulement trois membres d'équipage, le capitaine entama son drôle de voyage inaugural.
Dès qu'il s'ancrait quelque part, l'Idaho était pris d'assaut par des soldats qui arrivaient de partout à la nage. Impuissant (?!) Newcomb regardait alors les dégâts que les filles ivres et les soldats qui ne l'étaient pas moins , causaient à son bâtiment. Quand il parvint à Louisville il fut envoyé sur Cincinnati, de là à Newport (Kentucky) ou il fut renvoyé sur Louisville qui le renvoya à nouveau sur Nashville !
Pendant tout ce temps, vingt huit jours de « croisière », il ne fut jamais admis à quais. Il perdit son bateau et toute la nourriture et les médicaments pour ses « passagères ». Les 4 300 $ qu'il réclama en dédommagement aux autorités fédérales lui furent payées ...en 1866 ! L'Idaho devait resté dans l'histoire comme « le bordel flottant » ...
|
|
Fin 1863 les autorités fédérales de la ville "prennent en charge" la prostitution locale, fournissant des licences aux filles ayant passé l'inspection conduite par le corps médical afin de dépister les maladies sexuellement transmissibles et les traiter. Celles qui refusaient de se plier à la règle étaient emprisonnées jusqu'à ce qu'elles obtiennent le certificat de "bonne santé". Apparemment le système s'avéra efficace; au 30 avril 1864, 352 filles étaient licenciées et 92 en traitement.
Devant le succès de l'opération, on étendit le contrôle aux prostituées de couleur. II semble que les manières et l'apparence des filles concernées se soit améliorées suite à ce programme sans précédent.
De part les garanties de sécurité et le confort qu'il offrait, il attira même, venant des villes du nord, de nombreuses "Cyprians" de la meilleure classe à Nashville …
L'hôpital N° 11 qui traitait les filles fut surnommé "la maison du fléau" . Au 31 janvier 1865, 207 femmes y étaient en cure. Au 31 décembre 1864, sur les 1 000 premiers soldats traités dans l'hôpital N° 15 (celui qui accueillait les yankees atteints ), seul 30 avaient contractés la maladie à Nashville, ce qui atteste de l'efficacité du système instauré sur place, mais aussi de l'échec ailleurs, Memphis exceptée, ou une opération similaire de légalisation et de contrôle de la prostitution connut un certain succès là encore.. Bien sur, une fois la guerre terminée, ces expériences furent arrêtées…
|
 |
A gauche, Licence délivrée à Anna Johnson par les autorités militaires US à Nashville |
| A droite, la prostituée Bettie Duncan a satisfait à l'examen de santé hebdomadaire, le 30 décembre 1863. (National Archives) |
 |
|
En règle général, la prostitution pendant la guerre de sécession est largement tolérée car reconnue comme un mal , mais comme un mal nécessaire , tout comme dans la société victorienne en temps ordinaire d'ailleurs. Les appétits charnels (des hommes uniquement bien sûr) étant bien connus, ils doivent être apaisés.
En offrant aux soldats un dérivatif à leurs frustrations, les prostituées contribuaient ainsi à préserver la si précieuse vertu des femmes respectables que l'on pensait , à tort ou à raison, en grand danger ! P.AILLIOT
Sources : « Sex in the CW » T.P. Lowry « Prostitution in mid XIXth century America » E.A Topping |
|
Quelques termes d'époque en matière de prostitution Brothel (bordel) : House of ill repute (maison de mauvaise réputation), Sporting house (maison sportive), Temple of Venus (temple de Vénus), Den of Vice (antre du vice), Disorderly house (maison déréglée)
SOURCES |
Édouard 7 et sa fameuse chaise de volupté
Le roi d’Angleterre Édouard VII est mort le 6 mai 1910.
Ce roi est très populaire en France (vous pouvez relever le nombre d’hôtels, de places, de théâtres... qui porte son nom un peu partout en France).
Amoureux de la France (il passera ses vacances à Biarritz),
il fut le principal acteur de la réconciliation entre la France et l'Angleterre en conflit pour des différents coloniaux.
En effet, en 1903, il décide de rencontrer le président français. Son arrivé s'effectue sous les hués du peuple français mais le pittoresque du roi, sa bonhomie, ses manières simples et sa courtoisie sans façons ont séduit les Français.
Il a conquis le cœur de la population.
Il faut dire que ce roi connaissait la France.
Dans sa jeunesse, en tant de prince de Galles, il y a séjourné plusieurs fois à Paris et fréquenté les théâtres, les cabarets ainsi qu'un haut lieu de la galanterie
« le Chabanais »
- Dieu seul sait quels souvenirs il en garde…
Client de cette maison close,
il avait fait installer un mobilier personnel et… particulier.
Dans une grande baignoire de cuivre rouge ornée d’une sphinge aux attributs déployés, le futur roi barbotait dans du
champagne Mumm cordon rouge tout en se faisant dorloter.
Autre meuble célèbre due à l’imagination d’Edouard VII, une chaise « de volupté » fabriquée spécialement dont je vous laisse en imaginer l’usage.
Petit anecdote concernant cet établissement.
On raconte que lorsqu’un hôte de marque désirait visiter les lieux,
son programme officiel mentionnait :
« Visite au président du Sénat ».
Un membre du protocole ne comprit pas l’allusion et plaça un jour cette visite sur le programme de la reine mère d’Espagne.
On dû en catastrophe organiser une véritable visite au président du Sénat, qui n’en demandait pas tant !





Les Tuileries et les galeries du Palais-Royal sont le centre de la prostitution parisienne au XVIIIe siècle. Au cours du XIXe siècle, les maisons closes s’éparpillent dans Paris, notamment sur les grands boulevards où foisonne la vie ainsi que dans les passages couverts à l’architecture moderne et à la forte fréquentation, où tout se vend et tout s’achète. Les galeries du Palais-Royal sont peu à peu délaissées.

Les maisons closes ou borgnes tiennent leurs noms de leur architecture spécifique : tournées vers l’intérieur, elles présentent des façades dépouillées et neutres, aux fenêtres souvent grillagées ou masquées pour empêcher les femmes de racoler.
En revanche, l’intérieur est très soigné et les décors théâtraux, la maison s’articule autour d’un escalier central desservant tout l’immeuble entièrement consacré à la prostitution.

Au-dessus de la double-porte d’entrée se trouve la mythique lanterne rouge, héritée des lupanars antiques, éclairant le numéro à la nuit tombée.
Certaines maisons portent parfois une enseigne. Les immeubles occupés par les maisons borgnes ne sont souvent large que d’une seule pièce, les rendant immédiatement reconnaissable depuis la rue.
Ne donnant aucune vision directe sur l'intérieur depuis la rue, la porte d'entrée s'orne parfois d'éléments de décor attrayants tandis que les clients quittent l'endroit par une porte dérobée.

Au XIXe siècle, la maison close est un endroit chic que les hommes d'affaires comme les étudiants côtoient sans se cacher. 200 établissements officiels, contrôlés par la police et des médecins sont recensés dans Paris.
L'Etat profite du commerce en prélevant par l'intermédiaire du fisc, 50 à 60 pour cent sur les bénéfices.
Entre 1870 et 1900, 155 000 femmes sont déclarées comme prostituées ; à ce nombre s'ajoutent de nombreuses femmes qui pratiquent la prostitution clandestine.
En 1911, la police autorise les « maisons de rendez-vous », moins identifiables de l’extérieur, où les prostituées ne vivent pas mais viennent seulement travailler.

Ces établissements modernes font la satisfaction d’une clientèle aisée et discrète dans les années 20.
Parallèlement à ces maisons officielles, on trouve des cafés à serveuses
« montantes » ou des instituts de bains et de massage à la prostitution déguisée. Mais il existe un type de maison close destiné au bas de l’échelle sociale, les maisons d’abattage.
Soumises à la même réglementation que les maisons closes classiques ou luxueuses, le travail s’y effectue à la chaîne. La clientèle est constituée d’ouvriers ou de soldats. Les plus grandes de ces maisons peuvent faire travailler jusqu’à 50 femmes soutenant un rythme effréné (chacune peut recevoir plus de 20 clients par jour).

Rue Blondel
La prostitution est soumise à une réglementation qui s'élabore au fil des ans. En 1796, Napoléon institue un registre de la prostitution, quelques années plus tard en 1802, la visite médicale devient obligatoire.
La légalisation de la « tolérance » et des maisons closes se précise en 1804 : une brigade des mœurs contrôle les filles et les maisons. Les prostituées doivent alors s'inscrire d'abord à la préfecture et ensuite dans une maison. Les filles des rues sont dites « en carte », celles des maisons closes sont dites « à numéro ».
Le règlement détaillé édité en 1823 par le préfet de police Dubois reste inchangé jusqu’en 1946.

La mise en place d’un système de tolérance implique une surveillance sanitaire dès la fin du XIXe siècle.
Au début du XXe, la propagation des maladies vénériennes, dont la syphilis, alerte les autorités : les débats portent à la fois sur les questions d’hygiène et sur la moralité, remettant en cause la réglementation existante considérée comme hypocrite.

Rue Sainte Appoline
Le Comité national d’Etudes sociales et politiques créé par Albert Kahn se penche sur ces questions et publie plusieurs rapports en 1928.
L’idée de l’abolitionnisme fait son chemin et le 13 avril 1946, le projet de loi sur la fermeture des maisons closes initié par l’ancienne prostituée Marthe Richard est finalement voté.
1500 établissements, dont 180 à Paris, ferment leurs portes.

L’image codifiée de la maison close est ancrée dans la mémoire collective, peu modifiée en un siècle et demi d’existence officielle : gros numéros, persiennes et lanternes rouges ont été fixés et diffusés par les artistes, observateurs ou amateurs de ces paradis artificiels.

L’évocation des maisons closes et des lieux de plaisir peuple le monde de l’artà l’entre deux guerre, assouvissant l’infini besoin d’étourdissement et de jouissance qui caractérise cette période.
La crise de 1929 met fin à ces années vouées aux plaisirs légers.

http://albert-kahn.hauts-de-seine.net/archives-de-la-planete/dossier/maisons-closes/
photos google

Jetons pour maisons closes.
